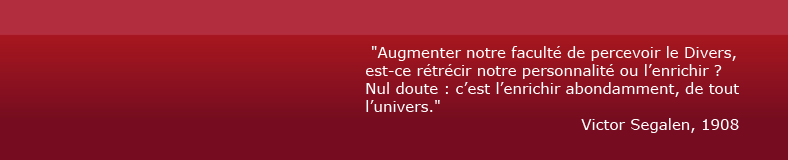Imprimer  |
|


D’Afrique de l’Ouest aux Antilles, des créoles portugais dynamiques
Posté par Nicolas Quint le 8 septembre 2011

Nicolas Quint est Directeur de Recherches en linguistique africaine au CNRS (laboratoire LLACAN – Langage, Langues et Cultures d’Afrique Noire, INALCO/CNRS). Depuis 1995, il travaille sur les créoles afro-portugais (capverdien, casamançais et papiamento) auxquels il a consacré plusieurs dizaines de publications.
D’un côté à l’autre de l’Atlantique, on trouve un groupe de créoles à base portugaise présents dans trois pays d’Afrique de l’Ouest (le Cap-Vert, la Guinée-Bissao et le Sénégal) et aux Antilles néerlandaises. Malgré la distance géographique, ces créoles sont génétiquement apparentés et ils sont regroupés sous l’appellation CPAO (Créoles Afro-Portugais de l’Afrique de l’Ouest, en anglais Upper Guinea Creoles).
Quels sont ces créoles ?
Les CPAO se regroupent en trois grands ensembles :
Le créole capverdien , parlé comme langue maternelle par environ un million de personnes dans le monde, dont 500.000 au Cap-Vert et le reste dans la diaspora. Le capverdien se subdivise lui-même en deux groupes dialectaux : les créoles des Îles-au-Vent (Barlavento), pratiqués dans les îles du Nord de l’Archipel du Cap-Vert et les créoles des Îles Sous-le-Vent (Sotavento), pratiqués dans les îles du Sud de l’Archipel.
Les créoles afro-portugais dits « continentaux », à savoir :
– le guinée-bisséen, principale langue véhiculaire de Guinée-Bissao, avec plus d’un million d’utilisateurs dont au moins 500.000 locuteurs natifs,
– le casamançais, pratiqué dans la région de Ziguinchor au Sénégal par plusieurs dizaines de milliers de personnes,
– les parlers créoles de la Petite Côte sénégalaise (Joal, Saly-Portudal et Rufisque), aujourd’hui tous éteints.
Le papiamento, créole afro-ibérique parlé par près de 300.000 personnes dans les Antilles Néerlandaises (îles ABC = Aruba, Bonaire, Curaçao).

De l’ouest de l’Afrique aux Antilles, des créoles apparentés
La proximité linguistique entre le capverdien et les créoles continentaux est si élevée que l’intercompréhension reste en grande partie assurée, en particulier en ce qui concerne le capverdien du Sud et le guinée-bisséen.
En ce qui concerne le papiamento contemporain, bien que l’élément espagnol y soit désormais majoritaire, des études comparatives récentes ont montré qu’il présente des ressemblances si nombreuses et si spécifiques avec le capverdien et les créoles continentaux qu’elles ne peuvent être raisonnablement considérées comme le fruit du hasard.
Selon toute vraisemblance, ces créoles ont donc une origine commune, une langue-mère (le ProtoCréole de l’Afrique de l’Ouest ou PCAO) qui a dû se former au cours du XVème siècle en Afrique de l’Ouest, lors des premiers contacts entre les navigateurs portugais et les populations africaines. L’existence de cette langue-mère est le seul moyen d’expliquer les nombreux points communs existant entre les différents CPAO, qu’ils soient parlés en Afrique de l’Ouest ou aux Antilles.
Ainsi, le mot signifiant ‘sombre/obscurité’ se dit sukuru en capverdien ainsi que dans les créoles continentaux et sukú en papiamento. Ces trois formes s’expliquent très probablement par l’existence d’une même forme originelle SUKURU (stade du PCAO), elle-même dérivée du portugais de la Renaissance escuro ‘sombre‘.
Quel avenir pour ces créoles?
Aujourd’hui la plupart des CPAO se portent bien :
– le capverdien et le papiamento sont massivement transmis aux enfants dans les territoires où ils sont pratiqués. Dans ces deux aires linguistiques, le créole est la langue de la rue, des bars, des fêtes, c’est celle dans laquelle chantent habituellement les groupes de musique locaux… Pour le moment, il ne semble donc pas que ces langues soient en danger.
– le créole de Guinée-Bissao est quant à lui en pleine expansion, au détriment des langues africaines atlantiques et mandées pratiquées dans ce pays.
La situation est en revanche plus alarmante pour le créole casamançais, toujours vivant mais rudement concurrencé par le wolof, le mandinka et le français.
Quelle que soit leur situation actuelle, il existe une menace à long terme pour l’ensemble des CPAO : à l’exception du papiamento, largement utilisé dans la presse quotidienne locale, ces langues sont encore peu employées à l’écrit.
Elles sont aussi largement absentes des systèmes scolaires des zones concernées, qui utilisent d’autres langues d’enseignement : le portugais au Cap-Vert et en Guinée-Bissao, le français au Sénégal et le néerlandais aux Antilles Néerlandaises.
En ce qui concerne le Cap-Vert et la Guinée-Bissao, où le portugais est langue officielle, on assiste à une intégration croissante d’éléments portugais dans les créoles locaux, ce qui pourrait à terme conduire à l’absorption progressive de ces créoles par le portugais.
Cependant, les autorités locales des différents pays concernés tendent à prendre de plus en plus ouvertement en compte le fait culturel créole : ainsi, au Cap-Vert, un système orthographique officiel a récemment été adopté par le Parlement et un premier Master de langue capverdienne a été inauguré par l’Université du Cap-Vert en automne 2010. Du côté antillais, le gouvernement d’Aruba a octroyé en 2003 un statut officiel au papiamento, à parité avec l’anglais et le néerlandais.
Autant de signes encourageants qui augurent d’un avenir prometteur pour les créoles afro-portugais de l’Afrique de l’Ouest…
*************************************************************************************
Pour en savoir plus, voir aussi :