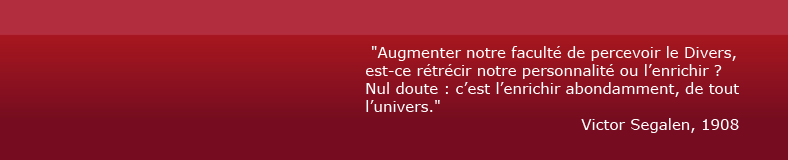Imprimer  |
|


Progrès et enjeux de l’enseignement en māori en Nouvelle-Zélande
Posté par Richard Hill le 13 cotobre 2011

Dr Richard Hill, Université de Waikato,
Hamilton, Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande, ou Aotearoa, comme l’appelaient les Māori il y a plus de 1000 ans, est un pays multiculturel comptant 4,4 millions d’habitants (Statistics New Zealand, 2011).
Comme les peuples autochtones de nombreux pays à travers le monde, les Māori, et en particulier leur langue, ont souffert des effets de la colonisation. En 1930, 97% des Māori parlaient couramment la langue. En 1970 ce chiffre avait chuté de 27%, conséquence de dizaines d’années d’endoctrinement, de politiques éducatives stériles et de transformation des mouvements de population.

Wanganui, Nouvelle-Zélande – classe de maori – Photo : Robert Thomson (cc)
L’arrivée du māori dans le système éducatif
Encouragés par un mouvement en faveur droits civiques qui prend de l’ampleur aux États-Unis dans les années 1970, et par une conscience grandissante des avantages de l’éducation bilingue, les Māori font leurs premières expériences en éducation bilingue dès la fin des années 1970. La première kohanga reo (« nid de langue » pour les maternelles) voit le jour en 1982, et mènera plus tard à une multiplication des structures d’enseignement māori partout en Nouvelle-Zélande, dont les Kura Kaupapa Māori (écoles primaires en immersion profonde) et les wharekura (collèges). En 2011, selon le Ministère de l’Éducation Néo-Zélandais, 14% des étudiants māori (soit 24 805 étudiants) suivent un enseignement māori sous une forme ou une autre.
Le māori à l’école, mais l’anglais à l’extérieur
Malgré les grandes réussites de ces 30 dernières années dans la restitution de la langue māori aux nouvelles générations, la revitalisation du māori n’est en réalité qu’un succès partiel. Les écoles forment de bons locuteurs de māori, mais son usage n’est que peu répandu en dehors des salles de classe.
L’avenir du māori ne sera assuré que si l’on traite la question, cruciale, de la transmission intergénérationnelle. Faire face à cette question signifie qu’une génération de parents māori, qui n’ont pas appris le māori quand ils étaient enfants, devra d’abord apprendre la langue pour ensuite la cultiver à la maison, et au-delà.
Quelle place pour l’anglais ?
La place de l’anglais au sein des programmes d’immersion en māori est une autre question à laquelle les écoles continuent de faire face. Inclure l’anglais dans les programmes est devenu d’autant plus important que c’est désormais une obligation pour les écoles d’enseignement māori.
Les premières années, les responsables de ces écoles estimaient qu’une immersion māori à 100% était nécessaire pour revitaliser la langue, et que l’instruction de anglais pouvait donc être laissée aux collèges, voire aux lycées.
Mais ces 10-15 dernières années, les attitudes se sont progressivement retournées vers l’idée que les étudiants avaient besoin de solides compétences dans les deux langues. Comment et à quel moment entamer l’enseignement de l’anglais ? C’est tout l’objet des négociations actuelles. En comparaison avec les programmes bilingues d’autres pays, la quantité d’anglais proposée par les kura kaupapa et les autres programmes d’immersion profonde est très faible, de nombreuses écoles proposant 120 à 720 heures d’anglais entre la 6ème et la 2nde.
Certaines écoles ont également tendance à recruter des enseignants externes pour assurer les cours d’anglais,plutôt que d’employer les enseignants travaillant déjà sur place, et ce dans l’idée qu’elles maintiennent ainsi un environnement« pur » d’immersion māori partout ailleurs dans l’établissement. Si un tel dispositif offre des avantages, le recrutement d’intervenants extérieurs coûte cher, et en raison d’un enseignement de l’anglais centré essentiellement sur la lecture et l’écriture, les étudiants ne sont familiarisés qu’avec un registre linguistique relativement étroit. Ce dispositif signifie aussi que les étudiants ne sont pas incités à transférer leurs compétences linguistiques d’une langue à une autre, puisque leurs enseignants ne parlent généralement pas māori.
À l’heure où de nombreux chercheurs encouragent les techniques d’instruction favorisant un transfert de compétence linguistique, les écoles d’enseignement māori tardent à expérimenter ces méthodes. Cette expérimentation n’aura lieu que si les perceptions changent vis-à-vis du rapport entre les deux langues étudiées. Les étudiants verront alors s’étendre leurs chances de devenir de solides bilingues et bialphabètes.
________________________________________________________________________________
References
Statistics New Zealand. (2011). Estimated Resident Population. from http://www.stats.govt.nz/tools_and_services/tools/population_clock.aspx