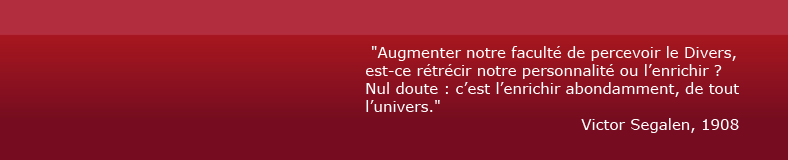Imprimer  |
|


Les Inuit du Groenland et les problèmes de l’enseignement des langues
Posté par Jean-Michel Huctin le 10 décembre 2010
Jean-Michel Huctin est doctorant en ethnologie à l’université de Paris Diderot et enseigne l’anthropologie arctique à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis 1997, il séjourne régulièrement dans une communauté inuit au nord du Groenland dont il parle la langue, le kalaallisut. Engagé dans la promotion de la culture inuit et dans des actions éducatives pour la jeunesse locale, il est par ailleurs le coauteur et coproducteur du premier film de fiction entièrement en langue groenlandaise, « Le voyage d’Inuk » (www.inuk-lefilm.com, sortie prévue en 2011).

Les élèves d’une classe du collège d’Uummannaq avec leur prof d’anglais groenlandaise – © Jean-Michel Huctin
Jusqu’à la fin des années 1970, le système éducatif au Groenland (dont 90% des 57000 habitants sont Inuit) a privilégié le danois, langue de la colonisation, au détriment de la langue autochtone majoritaire, le kalaallisut (groenlandais de l’Ouest, de la famille des langues eskimo-aléoutes). Résultat : le kalaallisut était en déclin accéléré, le niveau scolaire de la population stagnait très bas et des générations d’adultes (les plus de 30 ans ayant fait des études secondaires ou supérieures au Danemark) préfèrent lire et écrire le danois plutôt que le groenlandais (« c’est plus rapide ») lorsqu’ils ont le choix.
Grâce à l’action du premier gouvernement autochtone à partir de 1979 (le Groenland enfin politiquement autonome restait membre du Royaume du Danemark), le kalaallisut est devenu la langue nationale officielle et la première langue d’instruction. Avec l’accroissement du nombre d’enseignants autochtones, cet enseignement dans la langue maternelle a contribué à sauver le kalaallisut, devenu depuis l’une des plus solides langues de l’Arctique, et à accroître de manière continue le niveau éducatif de la jeunesse : les statistiques officielles montrent que le nombre de personnes ayant achevé une formation a presque doublé dans les dix dernières années (Statistics Greenland, 2005 et 2009).
Cependant, ce succès remarquable de l’école primaire et du collège n’a pas permis de supprimer la domination de l’ex-langue coloniale qui reste toujours aujourd’hui déterminante pour la réussite scolaire. Les raisons : la majorité des enseignants du lycée sont danois (souvent les plus qualifiés et occupant des postes de direction), de nombreux manuels scolaires ne sont pas traduits, le niveau des lycées est parfois considéré meilleur au Danemark, l’unique université groenlandaise n’offre que peu de formations, etc. La plupart des jeunes réussissant leurs études sont ceux qui maîtrisent le danois, y compris les enfants de couples mixtes qui n’ont pas appris leur langue maternelle. Certains Groenlandais disent même que beaucoup d’étudiants ne peuvent pas poursuivre leurs études parce qu’ils ne parlent pas danois.
Par ailleurs, les étudiants inuit du Groenland, comme les autres jeunes du monde entier, doivent aussi apprendre l’anglais qui élargira leur horizon international bien plus que le danois. Le système éducatif est donc trilingue et ces étudiants consacrent une grande partie de leur temps à apprendre des langues.
Les étudiants originaires de la côte est du pays, quant à eux, apprennent en famille le tunumiisut (environ 3000 locuteurs) alors que ceux de Thulé à l’extrême nord- ouest pratiquent l’inuktun ou avanersuarmiutut (environ 1000 locuteurs), langues minoritaires considérées comme dialectes par les autorités groenlandaises. Ils doivent de surcroît, comme leurs camarades de la côte ouest, apprendre les trois autres langues à l’école : le kalaalisut, le danois et l’anglais.
Une éducation qui nécessite trois langues, parfois quatre ! Ces immenses efforts linguistiques sont source de découragement et participent finalement à l’échec scolaire. Il ne s’agit pas là seulement de surcharge cognitive : avec l’abandon de leur propre langue maternelle pour la maîtrise requise de langues plus ou moins « étrangères » et parfois anciennement « coloniales », les étudiants groenlandais sont jugés à partir de nouvelles manières de penser, font l’expérience d’un contenu, de méthodes et d’évaluations pédagogiques différentes, sont comparés à d’autres étudiants qui n’ont pas eu à faire les mêmes efforts. Certains étudiants « se sentent dévalorisés », dénonce Aviâja E. Lynge (anthropologue groenlandaise spécialiste de l’éducation) « parce qu’ils doivent s’adapter à des standards occidentaux et parce que le système éducatif est trop différent de leur propre culture ».
Le vieux débat linguistique n’est pas terminé : il ravive régulièrement les passions de cette société inuit post-traditionnelle et ex-coloniale…