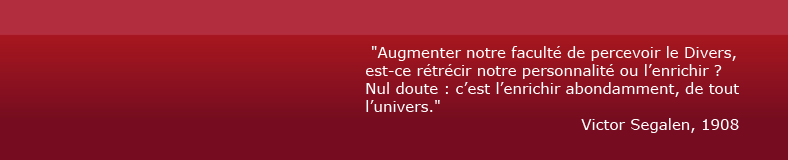Imprimer  |
|


Les langues celtiques — du déclin au renouveau ?
Posté par Sorosoro le 27 novembre 2010
James Costa est Chargé de recherche à l’Institut français de l’éducation, Ecole Nationale Supérieure de Lyon.

Croix celtique – Photo : Antonio Acuna (cc)
Les langues dites celtiques, qui regroupent l’irlandais, le mannois, le gaélique d’Ecosse, le gallois, le cornique et le breton, appartiennent à la famille des langues indo-européennes. Elles constituent un groupe à part entière, distinct des langues romanes, germaniques ou slaves. Seule l’une d’entre elles est langue nationale, l’irlandais (en concurrence avec l’anglais), et toutes sont aujourd’hui considérées comme « en danger », notamment par l’Unesco. Avec leurs derniers locuteurs, c’est un groupe entier de langues qui pourrait disparaître en tant que langue de communication avant la fin du siècle.
Une origine qui fait débat…
On a beaucoup écrit sur les langues celtiques et il est difficile de savoir exactement d’où elles viennent.
Elles ont enflammé les imaginations de nombreux poètes, romanciers ou linguistes depuis 1707, date à laquelle Edward Lhuyd, naturaliste gallois féru d’histoire antique constata une ressemblance entre les langues de Bretagne, Galles et Cornouailles d’une part (langues brittoniques), d’Irlande, d’Écosse et de l’île de Man (langues gaéliques) d’autre part.
Lhuyd relia également ces langues au gaulois, et leur attribua le nom de langues « celtiques », du nom grec donné à l’ensemble de peuples qui avait dominé l’Europe des siècles auparavant.
Les auteurs anciens sont les premiers à évoquer la présence de Celtes (keltoï en grec) sur une bonne partie de l’Europe Antique mais ils ne nous indiquent pas leur provenance originelle.
Les archéologues remontent plus loin dans le temps, puisqu’ils ont retracé les foyers et les migrations de ces Celtes à partir de l’Europe Centrale dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. (civilisations de La Hallstatt puis de La Tène).
Cela étant, cette hypothèse est aujourd’hui remise en cause par des recherches plus récentes qui, combinant archéologie, linguistique et génétique, suggèrent une origine au Portugal actuel, et une conquête de l’Espace européen par la façade atlantique.
En l’état actuel des recherches, nul ne peut donc dire avec certitude quel a été, ou quels ont été, les premiers foyers dont découleraient les langues celtiques modernes.
Le recul devant Rome au sud et les Germains à l’Est et au nord
Toujours est-il que ces langues, attestées dans une bonne partie de l’Europe de l’Ouest par de nombreux toponymes, font graduellement place à des formes de latin en Gaule, en Ibérie et dans le nord de l’Italie, et à des parlers germaniques en Allemagne, en Suisse et même sur l’île de Bretagne (la Grande-Bretagne actuelle), où la pratique de l’anglais progresse tout au long du Moyen-Âge.
Ainsi, le breton du royaume de Strathclyde (sud de l’Écosse actuelle) laisse place à l’anglais vers le 12e siècle. Au sud-ouest de l’actuelle Grande-Bretagne, la dernière locutrice de cornique est réputée avoir vécu au 18e siècle.
L’Irlande, non conquise par Rome, reste quant à elle monolingue « celtophone » jusqu’aux premières incursions normandes au 13e siècle, même si le latin était pratiqué par les moines.
C’est aussi d’Irlande que partira le mouvement de « gaélicisation» de l’Écosse à partir des 3e et 4e siècles, qui aboutira à la disparition du picte localement et à son remplacement par le gaélique, achevé au 12e siècle.

motif celtique – Photo : Bert23 (cc)
L’exception galloise
Langues de paysans et de pêcheurs, puis aussi de mineurs au Pays de Galles, les langues « celtiques » seront constamment ostracisées au cours des siècles car, dans les imaginaires des groupes économiquement dominants en Europe de l’Ouest, elles renvoyaient à la pauvreté et à un mode de vie considéré comme arriéré.
Seul le cas du gallois fait exception dans ce contexte : en effet, l’année 1588 voit paraître une traduction de la Bible dans cette langue, qui permet une utilisation normale dans les diverses chapelles galloises, et qui se maintient jusqu’à nos jours. Si le gallois était la langue de Dieu, il pouvait bien être celle des Hommes !
De la celtomanie du 19e siècle au revival des années 60
Vers la fin du 19e siècle, l’émergence d’une élite culturelle autochtone aboutit de la Bretagne à l’Écosse à l’émergence de mouvements de revendications culturelles centrés sur de la pratique de ces langues. Ces revendications se heurteront généralement aux exigences de la construction des État-nations modernes, conçus dès l’origine comme monolingues.
Les années 1960 sont l’occasion d’un revival des cultures locales à l’échelle mondiale, et divers mouvements linguistiques cherchent à faire prendre conscience de la portée universelle de ces cultures, et de la dignité de ces langues.
Et aujourd’hui ?
En ce début de 21esiècle, le breton est pratiqué par moins de 200 000 personnes. Selon les recensements de la République d’Irlande, près d’un million et demi de personnes pourraient parler irlandais, mais la langue serait en fait pratiquée quotidiennement par moins de 10 000 personnes. Le gaélique d’Écosse serait quant-à-lui utilisé par 55 000 personnes environ.
Enfin, le cornique et le mannois sont dans des situations particulières :
– le cornique a cessé d’être pratiqué au 18e siècle, même si actuellement près de 2 000 personnes utilisent une variété de cornique reconstruit au 20e siècle à partir de textes médiévaux ;
– le mannois a été enregistré auprès de ses derniers locuteurs « traditionnels », et il est aujourd’hui de nouveau pratiqué sur l’île de Man, et considéré comme officiel par le gouvernement local.
Là encore, seul le gallois semble échapper à ces dynamiques de déclin : pour la première fois depuis cent ans, le nombre de personnes déclarant parler gallois lors du recensement de 2001 était en hausse, et dépassait 600 000 personnes. Ce revirement s’explique par une très forte pression militante au cours des dernières décennies, qui fait que le gallois est actuellement largement présent dans tous les secteurs de la vie publique, tant dans les médias qu’à l’école ou dans l’administration.
Bien que moins éclatant, le renouveau est aussi perceptible dans les autres pays celtiques, et au-delà en Amérique du Nord et en Australie. Les langues celtiques ne sont plus, sauf exception, des langues de communication usuelle en dehors des foyers, mais elles trouvent désormais à s’exprimer dans d’autres fonctions, identitaires en particulier.
******************************************************************************
Pour aller plus loin
Abalain, H. (1989). Destin des langues celtiques. Gap: Ophrys.
Crystal, D. (2005). Revitalizing the Celtic Languages. Paper presented at the XI Annual Conference of the North American Association for Celtic Language Teachers. Retrieved from http://www.davidcrystal.com/DC_articles/Langdeath2.pdf
Dorian, N. C. (1981). Language Death : the Life Cycle of a Scottish Gaelic Dialect. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Filippula, M., Klemola, J., & Paulasto, H. (2008). English and Celtic in Contact. New York & Abingdon: Routledge.
McLeod, W. (Ed.). (2006). Revitalising Gaelic in Scotland. Edinburgh: Dunedin Academic Press.
Sur les origines des langues celtiques
Cunliffe, B, & Koch, J. (2010) Celtic from the West. Oxford: Oxbow.
Pour apprendre ces langues
Costa-Lynch, J. (2005). Le gallois de poche. Paris: Assimil.
Press, I., & Le Bihan, H. (2003). Colloquial Breton. London & New York: Routledge.
Taylor, I., & Robertson, B. (2003). Teach Yourself Gaelic. London: Teach Yourself.
Le Bihan, H., Denis, G., & Ménard, M. (2009). Le breton pour les nuls. Paris: First.
Ó Sé, D. & Sheils, D. Teach Yourself Irish. London: Teach Yourself.