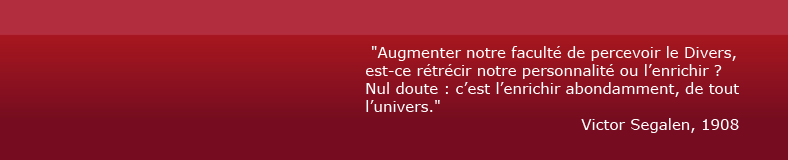Imprimer  |
|


Le veuvage chez les Akelé
Voici venu le moment de clore notre série sur les différentes facettes du mariage chez les Akélé du Gabon, et cette série se termine logiquement avec… la mort et le veuvage, en particulier celui des femmes.
C’est encore Papa Kédine, patriarche d’une petite communauté akélé dans la région des lacs autour de Lambaréné, qui en parle dans une courte interview. Il y décrit la pratique du lévirat, qui désigne le remariage d’une veuve avec un frère de son défunt mari, cette union devant assurer la sécurité matérielle de la femme et de ses enfants.
Durant l’Antiquité, le lévirat était pratiqué notamment par les Égyptiens et les Phéniciens. On en trouve également trace dans la Bible, en particulier dans l’histoire d’Er et d’Onan. Sous sa forme biblique, le lévirat prend effet uniquement si le frère encore vivant n’a pas eu lui-même de descendance masculine, afin de perpétuer le nom du défunt et d’assurer la transmission du patrimoine.
En Afrique, l’usage est plus large et peut revêtir plusieurs formes, selon les communautés, selon l’âge de la veuve et sa capacité à procréer, et selon que le frère vivant a déjà une ou plusieurs épouses. La sociologue Isabelle Gillette-Faye précise par exemple que cette tradition peut amener les femmes à vivre avec un homme qui deviendra, ou est déjà, polygame. « Mais il n’y a pas obligatoirement rapport sexuel. Si la veuve est suffisamment jeune pour enfanter, elle aura des enfants avec le nouveau mari qui, plus tard, participeront à l’amélioration du quotidien de la communauté ». Dans un autre cas, celui où un polygame décède, ce sont ses fils qui se marieront aux co-épouses de leur mère biologique.
Cela étant, l’institution du lévirat est aujourd’hui largement remise en cause, même en Afrique, car cette coutume dont l’objectif premier était de protéger les veuves se retrouve dévoyée à des fins plus mercantiles : le nouveau mari héritant de sa nouvelle épouse, de plus en plus d’hommes n’accepteraient la charge d’une nouvelle famille que pour récupérer l’héritage. De nombreux témoignages font état de situations où les hommes prennent les parcelles de terre et le bétail, puis les revendent pour avoir de l’argent, et laissent ensuite la femme se débrouiller seule avec ses enfants.
Au Kenya, le lévirat a même été perverti jusqu’à l’apparition de » laveurs de veuves « , véritables gigolos professionnels, payés par la belle famille pour s’emparer des biens des femmes ayant perdu leur mari…
A noter aussi : la pratique du lévirat coexiste souvent avec son pendant féminin, le sororat, qui veut qu’un homme veuf épouse la sœur de sa femme décédée. Mais là encore on constate des dévoiements de l’esprit premier de la tradition. Ainsi, lorsqu’une femme est stérile, elle est contrainte de fournir à son époux une sœur qui sera à même d’enfanter, mais les enfants à venir seront considérés comme ceux de la première femme.
Aujourd’hui, même si le lévirat est encore très largement en vigueur dans certains pays africains (Burkina Faso, Togo etc.), il a été interdit dans d’autres car considéré comme une pratique souvent forcée et allant de pair avec la polygamie. C’est le cas notamment au Bénin qui, en même temps que la polygamie, a banni cet usage le 17 juin 2004.
Linguiste : Jean-Marie Hombert
Image et son : Luc-Henri Fage
Traduction : Hugues Awanhet
Montage : Caroline Laurent