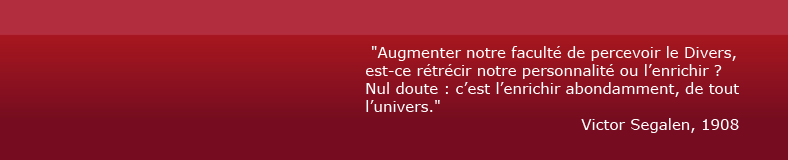Imprimer  |
|


Questions autour de la genèse des langues créoles
Posté par Marie-Christine Hazaël-Massieux le 21 juin 2011
Marie-Christine Hazaël-Massieux est professeur de linguistique à l’université de Provence. Elle est l’auteur de Textes anciens en créole français de la Caraïbe : histoire et analyse, Publibook, 2008.

Que signifie le mot « créole » ?
Il convient de souligner l’ambiguïté du mot créole. Il est souvent entendu comme synonyme de « langue mixte » – un concept d’ailleurs difficile à cerner – et on oublie qu’il est d’abord un adjectif caractérisant tout « produit » né aux îles de parents venus d’ailleurs : c’est ainsi que l’on parle par exemple de « vaches créoles » ou de « cochons créoles », et par la même occasion d’enfants créoles (Blancs créoles ou Nègres créoles).
Au départ, ce terme ne signifie donc absolument pas « métissé » mais rappelle que les parents/ancêtres ne sont pas originaires de la colonie.
Maîtres et esclaves
Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on a vu naître des langues créoles (langues des populations créoles) dans beaucoup de colonies européennes qui, selon l’origine des colons, sont appelées créoles portugais, créoles anglais, créoles français…
Les créoles à base française sont tous nés dans des situations de contacts linguistiques intenses, faisant intervenir les langues parlées par les maîtres et par les esclaves. Venus de diverses régions d’Afrique, ces esclaves parlent des langues très nombreuses qui ne leur permettent pas de se comprendre et d’être compris.
En outre, ils remplissent, au cours des décennies, des fonctions nouvelles et variées : ouvriers agricoles, d’abord, mais aussi artisans, ouvriers spécialisés dans les différents domaines utiles à la vie de la colonie, domestiques servant dans la « grand’case » et même parfois progressivement affranchis, marchands ou négociants pour s’occuper des affaires du propriétaire à la ville – ce qui permet d’expliquer la complexification et l’enrichissement progressif de la langue locale de communication, qui ne supplante cependant jamais complètement le français dans certaines fonctions.
Les non-Créoles qui débarquent sont eux aussi amenés à apprendre le « parler des îles », qui connaît ainsi des transformations rapides. Il devient moyen de communication pour l’ensemble de la société (missionnaires, maîtres, commerçants…) au fur et à mesure que celle-ci se développe. Et c’est à la fin du XVIIIe siècle qu’on se met à le désigner comme « créole ».
Si l’origine française apparaît souvent plus aisée à démontrer dans les créoles que l’influence, pourtant certaine, des langues des esclaves, c’est parce que :
- dans la recherche d’une langue de communication quotidienne commune entre maître et esclaves la domination sociale du maître fait que sa langue s’impose comme langue de communication quotidienne, sous la forme d’un français approximatif qui sert aussi pour les échanges entre esclaves quand ceux-ci n’ont pas de langue africaine commune
- toute promotion sociale semble alors passer par le français (cf. rôle des femmes, à la fois servantes, nourrices et concubines) et les esclaves tentent d’acquérir cette langue dans la perspective d’un affranchissement.
- les premiers scripteurs de l’idiome local sont francophones et tendent à interpréter en direction du français qu’ils connaissent les formes qu’ils entendent dans la bouche des esclaves.
Les textes anciens
Dès le début du XVIIIe siècle dans la Caraïbe, un peu plus tard dans l’Océan Indien, des documents écrits montrent l’existence de langues créoles, pas encore clairement distinctes d’une île à l’autre à l’intérieur d’une zone géographique donnée.
Par ailleurs, les langues en présence, en particulier les langues africaines, ne sont pas les mêmes dans la Caraïbe et dans l’Océan Indien et cela suffit à expliquer déjà en partie l’existence de différents créoles.
Les témoignages écrits de ces temps de genèse sont précieux et permettent de suivre au fil des années, puis des siècles, les évolutions de ces langues : les échanges, fort rudimentaires à l’origine, deviennent progressivement des énonciations élaborées, développant toutes les fonctions nécessaires ; la langue se construit, avec les ajustements progressifs qui s’effectuent au cours des décennies pour satisfaire la nécessité de communiquer.
La longue maturation des langues créoles
Au cours du XIXe siècle, on voit se fixer les formes les plus caractéristiques de chaque créole. Le lexique, à base principalement française, sait accueillir de nouveaux mots, souvent d’origines africaines diverses mais aussi du malgache, voire des langues de l’Inde, pour les créoles de l’Océan Indien. Et comme toujours, les nouveaux mots poursuivent, tant au plan sémantique que formel, leur évolution au cours des siècles.
Le plus caractéristique, toutefois, et le plus fascinant est bien de voir se développer une grammaire originale et fonctionnelle, née précisément dans ces situations de contacts linguistiques alors que chacun tente d’interpréter la langue de l’autre. Les unités grammaticales que l’on parvient à dégager et analyser, lorsque l’on veut tenter de les mettre en relation avec des formes attestées antérieurement, apparaissent comme profondément transformées. Souvent elles ne peuvent même être que très difficilement rattachées à une langue plutôt qu’à une autre, en raison de l’évolution rapide des formes grammaticales par rapport aux formes lexicales. D’où viennent exactement des morphèmes grammaticaux comme « ap », « ka » (à valeur de progressif), « ti » (passé), « ké » (futur, qui supplante un « va » d’origine), « i » (modal ou aspectuel en réunionnais), etc…? Les solutions qui consistent à rapprocher ces formes de formes françaises en usage sont séduisantes, mais on peut douter qu’elles soient suffisantes.
L’analyse systématique des textes anciens permet de mettre à jour les chemins de cette évolution jusqu’aux langues créoles modernes – langues complètes qui permettent de tout dire à qui sait les pratiquer en recourant aux formes lexicales et grammaticales qui les constituent.