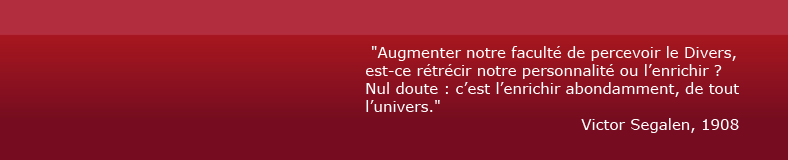Imprimer  |
|


20 janvier : le plurilinguisme au Sénat fait débat en Espagne
Petite révolution au Sénat espagnol : quatre langues régionales viennent d’y être officiellement autorisées. En plus du castillan, les sénateurs peuvent donc désormais débattre en galicien, en basque, en catalan et en valencien. Une initiative venue d’une trentaine de parlementaires, et soutenue par les socialistes au gouvernement.
Conséquence : 25 interprètes se relaieront afin de traduire tous les débats, pour un coût supplémentaire de 350 000 euros par an. Cette information a tôt fait de déclencher quelques levers de boucliers, comme le rapportent divers journaux et blogs, et notamment celui d’Elodie Cuzin, la correspondante à Madrid de Rue89.
Le leader de l’opposition, Mariano Rajoy (Parti populaire) n’y voit qu’un « gaspillage ridicule », malvenu en temps de crise. Particulièrement virulent, il a accueilli l’inauguration du service de traduction par un glaçant : « Ca n’arriverait pas dans un pays normal » avant d’ajouter que « les langues sont là pour se comprendre et non pas pour créer des problèmes ».
La sénatrice socialiste Carmela Silva, ardente défenseure de cette mesure, a quant à elle répondu que le Sénat étant la chambre territoriale, il est logique d’y « normaliser la pluralité ».
Alors, une exception, l’Espagne ? Madrid n’est certainement pas le seul cas où le plurilinguisme pose question. A Bruxelles par exemple, au niveau de l’Union européenne, plusieurs partis conservateurs dénoncent régulièrement le coût induit par la traduction de chaque document dans les 23 langues officielles.
Mais mettre en place un service de traduction dans plusieurs langues est-il vraiment une dépense inutile ? Est-ce une lubie de pays riches qui se préoccupent de questions futiles ? Il est permis de penser que non, si l’on regarde du côté de la plus grande démocratie au monde : ce sont en effet également 23 langues qui sont inscrites dans la Constitution de l’Inde, et la question de la traduction des débats au Parlement ne provoque là-bas l’ire d’aucun responsable politique.
L’UE et l’Inde ont d’ailleurs signé une déclaration commune sur le multilinguisme en 2009. A cette occasion, le commissaire européen au multilinguisme, Leonard Orban, a vanté l’excellente gestion par l’Inde de sa diversité linguistique. Celle-ci existe depuis le début de l’histoire du pays et est considérée comme parfaitement naturelle.
Le ministre espagnol de la Justice, Francisco Caamano, défendeur du plurilinguisme au Parlement, a justement fait remarquer que « certaines valeurs valent plus que leur simple coût ». Car rappeler sans cesse le coût du multilinguisme revient à occulter le coût, peut-être encore plus grand, de l’uniformité culturelle et la disparition des langues dites « minoritaires ». La pluralité a certes un prix, mais elle induit le respect de l’autre qui permet de vivre ensemble. Qui se réjouira le jour où tous les parlementaires du monde s’exprimeront uniquement en anglais… ?
Lire le blog d’Elodie Cuzin sur Rue89