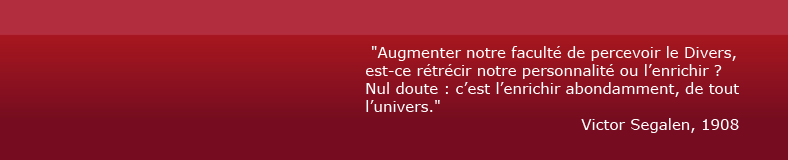Imprimer  |
|


Le symbole, suite : au Burkina Faso
Posté par Rozenn Milin le 18 janvier 2010

Rozenn Milin est directrice de Sorosoro, journaliste et réalisatrice
A la suite de notre article sur la pratique du « symbole » comme « moyen d’éducation » dans les pays occidentaux, une pratique que nous avons retrouvée au Gabon lors d’un de nos tournages, une internaute nous a fait connaître une autre publication qui y fait écho : Amadé Badini, professeur de sciences de l’éducation à l’Université de Ouagadougou au Burkina-Faso, y fait état de pratiques similaires toujours en vigueur dans son pays.
Nous vous en donnons les premières lignes et vous en recommandons la lecture intégrale sur le site de l’Unesco:
«Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,
Faites, je vous en prie, que je n’y aille plus»
Cette «Prière d’un petit enfant noir», écrite dans les années 50 par le Guadeloupéen Guy Tirolien, conserve malheureusement toute son actualité en Afrique noire, où l’école exerce une violence sur l’enfant dès son arrivée en classe. Au Burkina-Faso, par exemple, elle l’oblige à passer, sans le moindre aménagement psychologique, de sa langue maternelle à une langue étrangère, en l’occurrence le Français, qui s’imposera désormais à lui comme le seul critère de la réussite.
Au 1er octobre, l’année de ses sept ans, il est interdit à l’enfant — au moins dans les limites de l’école — de faire un quelconque usage de la langue nationale qu’il maîtrise: le mooré, le peuhl, ou le dioula… Il est contraint de faire l’apprentissage de l’écriture dans une langue qui n’est pas la sienne, à travers des textes qui évoquent le village français avec son clocher, et selon des programmes qui lui feront étudier Paris avant Ouagadougou.
Des châtiments humiliants — on lui accroche parfois un crâne d’âne au cou, avec cette étiquette «Âne, parlez français!» —, achèvent de le convaincre de l’atmosphère de conflit violent que l’école lui réserve. (…)