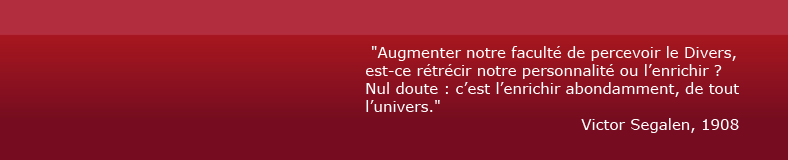Imprimer  |
|


Les couleurs
Il est intéressant de comparer les langues à partir de certains mots de la vie courante, qui sont – à priori ! – universels. Nos équipes de tournage ont ainsi pour consigne de demander à tous leurs interlocuteurs de nous donner dans leurs langues les noms des couleurs, des parties du corps, les chiffres de 1 à 10 (même si nous savons que toutes les populations de la terre ne comptent pas forcément de la même façon…), les expressions de la vie quotidienne etc.
Souvent, ces mots de base permettent de vérifier la proximité d’une langue à l’autre au sein d’une même famille linguistique. Par exemple, dans les langues indo-europénnes, les chiffres de 1 à 10 sont très similaires et confirment la parenté entre, par exemple, le kurde et le français ou le russe.
Les couleurs en punu
Le punu est la langue des Bapunu, la deuxième ethnie du Gabon en population. C’est une langue bantu parlée dans la région de Tchibanga. Le déplacement récent de Bapunu de plus en plus nombreux vers les grands centres urbains entraîne une perte progressive des connaissances de la culture et de la langue.
En savoir plus sur la langue punu
Voir toutes les vidéos en punu
Linguiste : Jean-Marie Hombert
Image et son: Luc-Henri Fage
Montage : Caroline Laurent
Les couleurs en mpongwè
Les Mpongwè sont, après les Pygmées Akowa aujourd’hui disparus, les premiers habitants de Libreville, sur la rive droite de l’estuaire du Gabon. Le nombre de locuteurs est réduit puisqu’on en compte moins de 5000. Conscients du danger de disparition de leur patrimoine traditionnel, les Mpongwè ont créé des structures pour la sauvegarde de la langue et de la culture.
En savoir plus sur la langue mpongwè
Voir toutes les vidéos en mpongwè
Linguiste : Patrick Mouguiama-Daouda
Image et son : Muriel Lutz
Montage : Caroline Laurent
Les couleurs en benga
Au Gabon, le benga est parlé sur la zone côtière (Cap Esterias et Cap Santa Clara) au nord de Libreville. Moins de 1000 individus sont aujourd’hui capables d’utiliser cette langue et ce chiffre est en constante diminution, en partie parce qu’ils s’intègrent progressivement dans la communauté myéné voisine.
Voir toutes les vidéos en benga
Linguiste : Patrick Mouguiama-Daouda
Image et son: Muriel Lutz
Montage : Caroline Laurent
Les couleurs en akélé
L’akélé est la langue des Akélé du Gabon. C’est une langue bantu, parlée par une population très dispersée à travers le pays. Les Akélé sont des pêcheurs et des agriculteurs qui vivent le long des fleuves Ogooué et Ngounié, et dans la région des lacs autour de Lambaréné.
En savoir plus sur la langue akélé
Voir les toutes les vidéos en akélé
Linguiste : Jean-Marie Hombert
Image et son : Luc-Henri Fage
Traduction : Hugues Awanhet
Montage : Caroline Laurent
Les couleurs en kaqchikel
Le kaqchikel est une des 30 langues mayas parlées au Guatemala et au Mexique, et l’une des plus parlées avec le k’ichee’, le yukateko, le wasteko, le mam et le q’eqchi. On estime en effet à environ un demi-million le nombre de ses locuteurs. Mais malgré une situation démographique à priori favorable, le kaqchikel se transmet de moins en moins et est en perte de vitesse chez les jeunes générations au profit de l’espagnol.
Voir toutes les vidéos en kaqchikel
Linguiste : Nikte Sis Iboy
Image et son : José Reynès
Montage : Caroline Laurent
Les couleurs en baynunk
Le baynunk est parlé en Casamance (sud du Sénégal) ainsi qu’en Gambie et en Guinée Bissau voisines ; c’est une langue Atlantique Nord (groupe Tenda-nyun), de la grande famille Niger-Congo. En 2006, le site ethnologue.com recensait environ 6200 locuteurs, ce qui en fait une « langue en danger » selon les critères de l’Unesco. Le baynunk fait partie des 17 langues bénéficiant du programme de codification et de reconnaissance des langues minoritaires entamé au Sénégal depuis les années 1970. Il est doté d’une orthographe officielle depuis 2005.
En savoir plus sur la langue baynunk
Voir toutes les vidéos en baynunk
Linguiste : Sokhna Bao-Diop
Image et son : Muriel Lutz assistée de Cheikh Tidiane Sall
Montage : Caroline Laurent
Vidéo réalisée dans le cadre du projet ANR Sénélangues
Les couleurs en syriaque
Le syriaque est une langue classique et liturgique appartenant au groupe de langues araméennes, issues de l‘araméen, une langue sémitique attestée par écrit dès le premier millénaire avant notre ère ! Elle devient au VIIème siècle avant JC la langue administrative de l’Empire néo-assyrien puis des empires néo-babylonien et perse, et la langue véhiculaire de tout le Proche et le Moyen-Orient. Au début de l’ère chrétienne, elle compte déjà de nombreux dialectes, et c’est dans l’un de ceux-là que Jésus prêchait et écrivait.
Lire la fiche sur les langues araméennes modernes
Voir toutes les vidéos en langues araméennes modernes
Images et son : Baptiste Etchegaray
Montage: Caroline Laurent
Les couleurs en tamasheq
Le tamasheq (ou tamajeq ou tamaheq, des dérivés du mot tamazight), est parlé par les Touaregs, un peuple nomade que l’on trouve dans des régions désertiques d’Afrique du Nord depuis des millénaires, sur une vaste zone qui va du Mali à la Libye et du Burkina Faso à l’Algérie en passant par le Niger. On compte environ 1 million de locuteurs de tamasheq.
Tout comme le kabyle, le chaoui ou le rifain, le tamasheq est en fait une des variantes du berbère (ou tamazight), un groupe de langues présentes dans toute l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Niger, Mauritanie, Mali et Burkina-Faso), sans compter une importante diaspora en Europe et en Amérique.
Voir toutes les vidéos en tamasheq
Image & son : Arnaud Contreras
Conseils linguistiques : Salem Mezhoud et Abdoulahi Attayoub
Montage : Caroline Laurent
Les couleurs en menik
Le menik est une langue de la famille Niger-Congo (branche Atlantique Nord, groupe Ouest-Atlantique, sous-groupe tenda) parlée au Sénégal, et comprend trois dialectes : le banapas, le biwol et le bëñolo. C’est dans la région de Kédougou, dans la localité de Bandafassi, que s’est déroulé notre tournage, en dialecte banapas.
Avec seulement un maximum de quelques milliers de locuteurs, la langue menik peut être considérée comme en danger à plus ou moins long terme. On constate cependant que, même si la majorité des locuteurs parle couramment le pulaar (peul) et le français, la langue se transmet encore dans les villages.
Les locuteurs du menik, bien qu’étant parfaitement intégrés à la culture environnante et ayant une grande perméabilité aux autres langues avec lesquelles ils sont en contact, sont réunis par un solide sentiment identitaire qui protège leur langue, dans une certaine mesure.
Voir toutes les vidéos en menik
Linguiste : Adjaratou Oumar Sall
Image & son : Muriel Lutz assistée de Cheikh Tidiane Sall
Traduction : Marcel Camara
Montage : Caroline Laurent
Vidéos réalisées dans le cadre du projet ANR Sénélangues