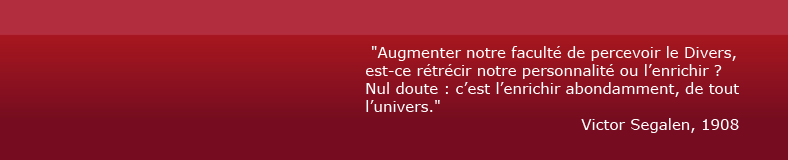Imprimer  |
|


Le kali’na
Données collectées par l’Union Latine qui œuvre à la mise en valeur de l’héritage culturel de ses 37 pays membres.
Données sur la langue kali’na
Noms alternatifs : galibi, kaliña, Carib (en), kariña, maraworno
L’appellation « galibi », venant de la période coloniale, est considérée comme désuète et est globalement rejetée (elle servait à désigner indistinctement toutes les populations de la famille caribe). Nous suivons ici la graphie retenue par les Kali’na de Guyane.
Aire : L’aire occupée par les locuteurs de kali’na est très étendue, le long des région côtières du nord-est de l’Amérique du Sud. Elle traverse 5 pays : le Venezuela, le Guyana, le Surinam, la Guyane française et le Brésil (sur l’Oyapock). La population kali’na installée au Brésil, aurait migré depuis la région de Mana (Guyane française) dans les années 1950.
Classification : Le kali’na est considéré comme une des branches primordiales de la famille des langues caribes. L’étude de kali’na a joué un rôle important dans la classification génétique de la famille caribe
Principaux dialectes : Selon Lescure (1988) il y a deux principaux ensembles dialectaux du kali’na : le dialecte oriental (celui de Guyane et de l’est du Surinam) et le dialecte occidental (allant du Venezuela à l’ouest de du Surinam).
Nombre de locuteurs : Peut-être 10 000 locuteurs
Note : En Guyane ; la Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane donne une estimation haute de 4 000 personnes ; selon F. et P. Grenand il y aurait 2 800 Kali’na (pas tous locuteurs). Ailleurs ; 11 150 Kali’na au Venezuela dont 30% de locuteurs seulement (recensement de 1992), 3 000 Kali’na au Guyana dont 80% de locuteurs (selon J. Forte), pas de chiffres disponibles pour le Surinam, une quarantaine de locuteurs seulement au Brésil. On trouve des émigrés aux Pays-Bas. Le nombre total de Kali’na doit se situer entre 20 000 et 25 000 personnes (mais selon F. et P. Grenand le nombre de vrais locuteurs ne doit pas excéder 10 000).
Statut de la langue : Pas de statut officiel
Vitalité et Transmission : Selon l’Unesco le kali’na est une langue en danger. Le degré de vitalité, toujours selon l’Unesco varie selon les pays où se trouvent les locuteurs.
Au Venezuela, selon Fabre (2005) tous les locuteurs sont bilingues en espagnol. On ne sait pas exactement combien de kali’na sont encore locuteurs de la langue, mais il semblerait qu’un abandon au profit de l’espagnol soit en cours.
On sait peu de choses de la vitalité du kali’na au Guyana et au Surinam. En Guyane française, une partie seulement de la population kali’na est locutrice de la langue. La situation de la langue varie beaucoup selon les communautés : à Awala-Yalimapo la langue est encore transmise, dans d’autres endroits, comme à Bellevue-Yanou, il y a une tendance à abandonner la langue au profit du créole guyanais, ou du français, comme à Kourou. Du côté surinamien l’abandon se fait au profit du sranan tongo.
Médias :
Journaux : Oka.Mag’ (bulletin d’actualités amérindiennes, essentiellement kali’na, rédigé en français, mais présentant dans chaque numéro un conte en langue kali’na).
Radio : Epanamatoko (émission de quelques minutes diffusée sur RFO)
Enseignement : Il existait jusqu’en 2009 une expérience de médiateur culturelle bilingue à l’école Yanamale d’Awala-Yalimapo, Guyane française.
Précisions ethnographiques
Les Kali’na, comme d’autres peuples de la même famille linguistique, sont vraisemblablement originaires de la région périphérique du Mont Roraima (Brésil et Venezuela), mais ils habitaient la zone côtière au moment de leurs premiers contacts avec les Européens au XVIe siècle. Dès les débuts de la colonisation, leur langue a intéressé les chroniqueurs, voyageurs et missionnaires qui ont laissé des grammaires, lexiques et catéchismes.
Précisions sociolinguistiques
Plusieurs normes orthographiques sont utilisées selon les pays. Celle du Venezuela est notoirement mauvaise, celle du Surinam meilleure mais présentant l’inconvénient d’être très axée sur la graphie du néerlandais. Une normalisation à vocation « internationale » a été adoptée par la majorité des Kali’na de Guyane en 1997.
Précisions linguisitiques
Le kali’na oriental, variante parlée en Guyane française de la langue kali’na, comprend 6 voyelles (dont une voyelle centrale fermée non arrondie, notée y, ï ou i, cette dernière notation actuellement préférée) et 12 consonnes (dont une glottale notée par l’apostrophe, et une latérale rétroflexe notée r ou l, la dernière notation étant actuellement plus courante). Il y a une règle systématique de palatalisation progressive (mouillure de la consonne suivant un /i/), et de sonorisation des occlusives /p/, /t/ et /k/ dans certains contextes. Ces phénomènes connaissent de fortes variations selon la situation géographique et la classe d’âge.
La morphologie est très complexe, particularité que le kali’na partage avec les autres langues de la même famille. De nombreux phénomènes morphophonologiques se manifestent aux frontières de morphèmes à l’intérieur du mot (harmonie vocalique, assimilation consonantique, alternances vocaliques, réductions syllabiques).
Dans le mot, les préfixes indiquent en général la personne ou le changement de valence (forme réfléchie, intransitivisation du verbe) et les suffixes indiquent le nombre, la relation de possession, le temps-aspect-mode, les changements de classe grammaticale.
Les verbes se divisent en transitifs et intransitifs. Dans les verbes transitifs, les préfixes personnels marquent le sujet lorsque les personnes de l’intralocution (1ère, 2ème, lère inclusive « moi et toi ») agissent sur une 3e personne objet : m-eyukui tu l’as invité(e) (où m- marque une 2e p. sujet avec 3e p. objet) ; mais les préfixes marquent l’objet quand on a une action de la 3e personne sur une personne de l’intralocution : ay-eyukui il (elle) t’a invité(e) (où ay- marque une 2e p. objet avec une 3e p. sujet). Cette hiérarchie des personnes est neutralisée dans les cas d’interaction entre personnes de l’intralocution : k-ayukui je t’ai invité(e) ou tu m’as invité(e, ; dans le cas d’une 3e personne agissant sur une 3e personne, c’est l’objet qui est marqué : n-eyukui il (elle) l’a invité(e) . Les verbes intransitifs sont divisés en deux sous-classes dont chacune prend l’une des séries de marques personnelles des transitifs : ainsi m-aimokii tu as embarqué, mais ay-auwai tu as ri. Cette scission de l’intransitivité est caractéristique de beaucoup de langues caribes, dans lesquelles on retrouve également un parallélisme entre les marques de personnes préfixées aux verbes, aux noms et aux postpositions, ainsi ay-emali ton chemin, ay-apolito à côté de toi.
Les noms sont soit aliénables (pouvant être ou non possédés), soit inaliénables (nécessairement possédés) : ainsi les parties d’un tout et en particulier les parties du corps, les termes de parenté, et les possessions personnelles telles que hamac, petit banc, arme, hotte de portage, animal domestique…). On a parfois des phénomènes de supplétion, p.ex. mule petit banc, mais ay-aponi ton petit banc.
La syntaxe des énoncés simples est construite suivant l’ordre préférentiel sujet-objet-verbe ou objet-verbe-sujet (avec de toutes façons une étroite solidarité entre l’objet et le verbe), éléments autour desquels peuvent apparaître des circonstants. Le groupe nominal possessif présente la succession déterminant (possesseur)-déterminé (possédé), ainsi maina emali le chemin de l’abattis, et le groupe postpositionnel la succession nom-postposition, ainsi maina apolito à côté de l’abattis. La négation s’opère à l’aide de la copule (« être ») et du verbe adverbialisé : auwa’pa wa je ne ris pas, littéralement « non-riant je suis ».
Les nombreuses particules modales, indiquant le degré d’engagement du locuteur par rapport à ce qu’il énonce, se placent toujours en seconde position dans l’énoncé, alors que les particules non-modales se trouvent immédiatement après le verbe, nom ou groupe nominal, groupe postpositionnel ou adverbe dont elles spécifient le sens. La subordination est généralement construite par des verbes nominalisés.
Vidéo sur un rite chamanique effectué en langue kali’na
En avril 2017, une délégation Kali’na (composée d’Alexis Tiouka, Maurice Tiouka et Monsieur Appolinaire) était présente au Festival du Chamanisme à Genac-Bignac, en France, pour y représenter leur peuple, ses traditions, et bien sûr sa langue, au travers de rituels comme celui présent dans la vidéos suivante. Ce rituel a été effectué avec des guérisseurs aborigènes Yalarrnga et Larrakia venus d’Australie.
https://vimeo.com/217641626
Sources
Délégation générale à la langue française et aux langues de France
IRD-Guyane, CNRS-CELIA (Eliane CAMARGO, Laurence GOURY, Françoise GRENAND, Pierre GRENAND, Michel LAUNEY, Odile LESCURE, Françoise LOE-MIE, Barbara NIEDERER, Marie-France PATTE, Francisco QUEIXALOS)
Fabre, Alain. 2005. Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. Consultable en ligne.
Renaut-Lescure, Odile. 2010. « Guyana Francesa ». In Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, UNICEF. Tome 1, Pp 380-394.
Liens complémentaires
Page consacrée au kali’na sur le site de Linguamón
Page consacrée au kali’na sur le site Le corpus de la parole
Pages consacrées aux « Galibi de l’oyapock » (Kali’na au Brésil) sur le site de l’ISA, Povos Indígenas no Brasil
Bibliographie
Alby, Sophie 2001. Contacts de langues en Guyane française: une description du parler bilingue kali’na-français.Thèse de Doctorat. Lyon: Université de Lyon II.
Alby, Sophie 2002. « Morts des langues ou changement linguistique? Contact entre le kali’na et le français dans le discours bilingue d’un groupe d’enfants kali’naphones en Guyane française ». Les Cahiers du RIFAL. Développement linguistique: enjeux et perspectives. Bruxelles.
Gildea, Spike 1994. « Semantic and pragmatic inverse: ‘inverse alignment’ and ‘inverse voice’ in Carib of Surinam ». In T. Givón (ed.), Voice and inversion: 187-230. Amsterdam.
Mosonyi, Jorge C. 2002. Diccionario básico del idioma kariña. Barcelona: Fondo Editorial del Caribe.
Renault-Lescure, Odile. 1985. « Les Galibi. La question amérindienne en Guyane ». Ethnies 1/2: 19-20.
Renault-Lescure, Odile.1991. « Contacts interlinguistiques entre le Karib et les créoles des côtes guyanaises ». Études Créoles 13/2: 86-94.
Renault-Lescure, Odile. 2001. « Dynamique des relations actancielles en kali’na de Guyane française ». Amerindia 26/27: 67-86. París.
Voir l’Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina et Fabre (2005) pour une bibliographie plus complète.
Si vous avez des informations complémentaires sur cette langue n'hésitez pas à nous contacter : contact@sorosoro.org