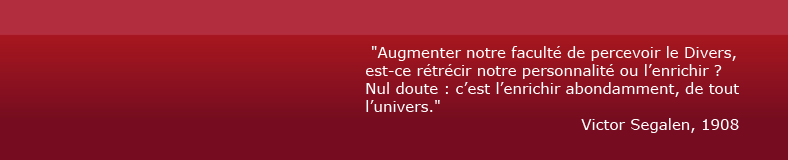Imprimer  |
|

Langues sifflées: le cas des Îles Canaries
Article écrit par Dimitra Hengen, publié le 14 octobre 2013 sur alphaomegatranslations.com (en anglais)
Les îles Canaries sont aujourd’hui considérées dans le monde entier comme un véritable paradis sur Terre. Tenant à l’origine leur nom de la population de chiens qui y vivaient (Canariae Insulae signifiant « les îles aux chiens » en latin), elles ont à leur tour, un peu plus tard, donné son nom à une espèce d’oiseau symbole d’exotisme. Il serait donc normal, pour toute personne visitant ces îles pour la première fois, d’avoir l’impression d’être entouré d’animaux sauvages en entendant des chants mélodieux résonner de vallée en vallée. Ces sifflements semblables à ceux des oiseaux sont pourtant d’origine humaine : il s’agit du mode de communication à distance d’une communauté locale de bergers. Cette langue – car il s’agit bien d’une langue, à ceci près qu’elle est sifflée – se nomme le silbo gomero, du nom de La Gomera, une des sept îles qui composent l’archipel et sur laquelle est pratiqué le silbo.
La préservation de cette langue est un enjeu aussi important qu’urgent, au même titre que la préservation des espèces animales et végétales de cette région. Le silbo est en effet considéré comme en danger depuis 1950, mais il aura fallu attendre 1999 pour que le gouvernement des Canaries rendent obligatoire l’apprentissage du silbo dans les écoles primaires. C’est en partie grâce à cette nouvelle politique linguistique que la langue a pu enfin connaître un regain d’intérêt et espérer une revitalisation.
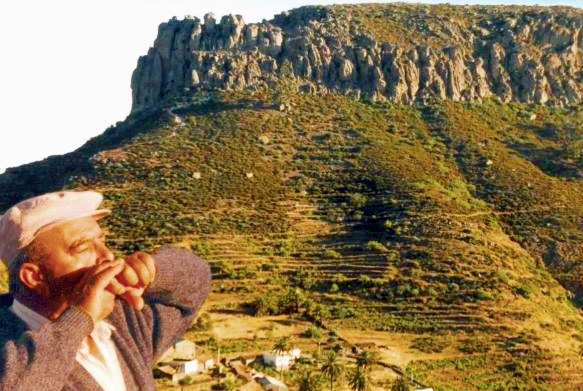
Le silbo était cependant déjà bien connu des linguistes depuis la moitié du XXème siècle, notamment avec Classe, et les premières traces de documentation remontent même à 1402 avec De Bethencourt. Cette langue proviendrait des Guanches, un peuple apparenté aux Berbères et vivant dans les Canaries, qui a disparu alors que l’île passait sous domination espagnole. Il aura ensuite fallut attendre 1891 pour que Lajard remarque que les sifflements ne représentaient plus du tout les sons de la langue berbère mais bien ceux de l’espagnol. Plus d’un siècle plus tard, Rialland remarqua à son tour qu’en plus de son utilité pour la communication entre les bergers d’une vallée à l’autre, le silbo avait également eu une utilité militaire, de défense de la colonie. Mais son travail, avec celui de Trujillo et Meyer, se concentra surtout sur l’analyse phonétique du silbo à l’aide de spectrogrammes. Ils purent ainsi confirmer que la langue avait des possibilité de combinaisons infinies, comme les langues parlées, et n’étaient donc pas qu’un simple code sifflé composé de semblant de phrases fixes.
Alors que Trujillo pensait qu’il n’y avait que deux voyelles et quatre consonnes possibles en silbo, Meyer découvrit plus tard que la langue pouvait en réalité compter cinq voyelles ainsi qu’une pléthore de consonnes. Il remarqua que les voyelles de l’espagnol étaient sifflées à différentes fréquences relatives les unes aux autres, la plus haute (ou plus aigüe) étant le [i], puis le [e], [a], et enfin [o] et [u], les voyelles situées aux fréquences les plus basses. Ces deux dernières voyelles sont en réalité sifflées à des fréquences similaires, mais le [u] étant beaucoup moins fréquent que le [o] en espagnol, cette proximité ne crée que très peu de confusions. Les consonnes, quand à elle, sont rendues en silbo à travers des interruptions particulières des sifflements et des modulations dans le sifflement des voyelles. Par exemples, les consonnes [p], [t], et [k] créent une réduction drastique dans l’amplitude du son, sonnant ainsi comme une interruption. De plus, selon l’analyse de Meyer, les sons [r] et [l] sont interchangeables, ce qui impose aux auditeurs d’interpréter le sens de la phrases selon le contexte.
Il est intéressant de noter que même les accentuations de l’espagnol sont reproduites en silbo, et ce grâce à une élongation des voyelles ou en les sifflants à une fréquence légèrement plus haute. Cette intonation est également utilisé pour marquer les questions ainsi que le son [ɲ].
La raison pour laquelle les langues sifflées peuvent parfois être limitées et ont des sons qui reposent sur des fréquences relatives les unes aux autres est lié à la capacité humaine de siffler. En effet, siffler en dessous de 1000hz est très difficile pour un humain. La nasalité (aussi bien pour les voyelles que pour les consonnes) est également problématique, le fait d’ouvrir la cavité nasale résultant dans une réduction du flot d’air, et donc une réduction de la puissance du sifflement. Enfin, il est compliqué de dépasser les limites d’une octave au sein d’une phrase.
Et pourtant, le silbo est la seule langues sifflées qui réussi cette prouesse, la gamme entière de le langue se situant 0.9 et 3.8 megahertz. Selon Rialland la lettre [a] est utilisée seule en début de phrase afin de « donner le la », permettant à l’auditeur de determiner sur quelles fréquences va se jouer la phrase. Si vous sifflez donc un [a] suivi du nom d’une personne, vous avez déjà commencé une conversation en silbo.
De nombreux site internet existent où il est possible de trouver des ressources, telles que des spectrogrammes de certains mots en espagnol, enfin de s’entraîner à les siffler et à apprendre le vocabulaire. Le silbo est sans aucun doute la langue sifflées pour laquelle il est le plus facile de trouver des ressources, du fait de son statut de langue protégée par l’UNESCO, et à la quantité de recherches qui ont été conduites à son sujet.
Alors si un jour vous partez en vacances à La Gomera, souvenez-vous que parmi toutes les mélodies qui flotteront dans l’air et parviendront à vos oreilles, certaines n’auront pas pour origine le chant des oiseaux ni la musique traditionnelle des groupes locaux !