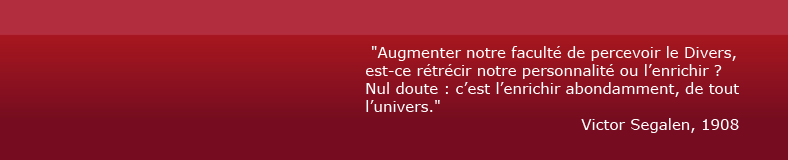Imprimer  |
|


La revitalisation du navajo aux Etats-Unis
Posté par Lucia Dumont le 14 mai 2011
Lucia Dumont est Docteure en civilisation américaine à l’Université de Cergy-Pontoise et chercheuse associée au centre de recherche Textes et francophonie.
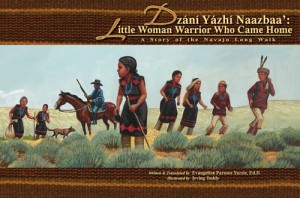
Couverture d’un livre bilingue racontant un épisode de la Longue Marche des Navajos par Evangeline Parsons Yazzie, professeur de langue et de culture navajo et co-auteur de la première méthode d’apprentissage du navajo agréée par les ministères de l’éducation des États d’Arizona et du Nouveau-Mexique.
Les Navajos forment une communauté de 269 202 personnes, dont la majorité, 180 762, vit dans une réserve s’étendant sur trois états du Sud-ouest des États-Unis, l’Arizona, le Nouveau-Mexique et l’Utah. L’isolement de ce territoire grand comme la Belgique, et les difficultés d’accès les ont protégé des influences extérieures pendant des siècles.
La langue navajo, quant à elle, appartient à la famille athabascane. C’est la langue autochtone des Etats-Unis qui compte le plus grand nombre de locuteurs : 178 014 selon le recensement de 2000.
Les causes d’un déclin
Plusieurs événements majeurs ont menacé la culture et la langue navajo au fil des décennies, à commencer par leur déportation de 1863 à 1868 loin de leurs terres ancestrales jusqu’à Bosque Redondo, un épisode appelé « La Longue Marche ».
Sur le plan économique, la pression sociale et l’extrême pauvreté des habitants ont facilité le transfert linguistique vers l’anglais, « la langue du pain ».
Enfin, sur le plan culturel, la scolarisation des enfants dans des pensionnats éloignés de leur famille, où il leur était interdit de parler leur langue, a été une expérience traumatisante. L’imposition d’un mode de vie matérialiste et la pression de groupes comme « English-Only », qui prônent une société monolingue de langue anglaise et décrivent les langues amérindiennes comme une entrave à l’intégration des peuples autochtones dans la société majoritaire, ont aussi largement contribué à l’abandon du navajo. Au bout du compte, éprouvant un sentiment de honte pour leur langue, les parents ont cessé de la transmettre à leurs enfants.
A la fin des années 60, néanmoins, 92,8 % de la population parlaient encore le navajo. C’est à cette époque que s’est effectuée la prise de conscience du déclin progressif de l’usage du navajo en tant que langue véhiculaire.
Les succès de l’école bilingue
En 1967 fut ouverte la première école communautaire par les Navajos, pour les Navajos, et avec le navajo comme langue d’instruction. Sa mission était d’instruire les enfants et les parents d’abord dans leur langue maternelle pour les amener progressivement vers l’anglais, afin de leur permettre de vivre et de réussir dans les deux mondes.
Le premier établissement d’études supérieures, le Navajo Community College, chargé de former les futurs enseignants bilingues, ouvrait quant à lui dès 1968.
En 1983 apparaissaient des écoles en immersion créées par des enseignants et des parents volontaires dans un environnement compatible avec l’identité culturelle des enfants. La première année tous les cours se déroulent en navajo, puis l’anglais est introduit progressivement, et à la fin de l’école élémentaire 50% des cours sont dispensés en anglais et 50% en navajo.
En 1984, enfin, le conseil tribal navajo adoptait officiellement une politique linguistique axée sur l’éducation bilingue.
Ces écoles ont favorisé l’assiduité des élèves et les statistiques montrent que ceux qui ont été instruits dans leur langue ancestrale obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs ayant suivi les cours uniquement en anglais. Dans certains cas, ces résultats dépassent même ceux des enfants anglo-américains dans les trois matières fondamentales : lecture, écriture et arithmétique.
Actuellement, les bilingues navajo / anglais sont recherchés comme interprètes assermentés pour les tribunaux d’Arizona et du Nouveau-Mexique. Ils forment l’élite politique, économique, intellectuelle et artistique de la Nation navajo, capables d’évoluer avec aisance dans les deux mondes.
Des difficultés liées aux problèmes sociaux
Malgré tous les efforts entrepris et les succès rencontrés, le nombre de locuteurs de navajo continue à diminuer. Et l’on note que le nombre des enfants parlant navajo en classe de maternelle dans la réserve décline depuis 30 ans : ils étaient 80% en 1980, ils ne sont plus que 15% aujourd’hui.
Plusieurs éléments rentrent en ligne de compte, tant pédagogiques (manque de professeurs qualifiés, forte rotation du personnel) que politico-financiers (dépendance des fonds fédéraux) et démographiques (disparition des anciens, détenteurs de la langue et des traditions). Mais au-delà de ces difficultés, les Navajos font face à un problème de fond : le départ de la réserve des jeunes les plus instruits, faute de développement économique.
En effet, dans cette enclave des États-Unis, selon les chiffres du recensement de 2000, 47,2 % des familles navajos vivent en dessous du seuil de pauvreté, une pauvreté endémique qui engendre beaucoup d’actes de désespérance (addictions, violences, suicides). Le taux de chômage est de 42,9% à 58% dans certaines régions et favorise la migration des jeunes vers les villes, où de plus en plus de Navajos réussissent dans les grandes universités !
La fierté de parler le navajo, qualifié de langue « de la victoire » (elle a permis aux Américains de remporter une bataille décisive dans le Pacifique grâce notamment aux célèbres Code Talkers navajos), les événements culturels tels que la fête de la langue, de la culture, les compétitions d’orthographe, l’élection de Miss Navajo qui doit être bilingue, biculturelle et éduquée, tout cela contribue au regain de fierté ethnique. Mais pourront-ils freiner le déclin annoncé et assurer la résilience du navajo dans une société favorisant le monopole de l’anglais ?
********************************************************************************
Sur les langues amérindiennes, voir aussi :
Les langues autochtones au Nouveau-Brunswick : un patrimoine menacé, par Elise Miranda