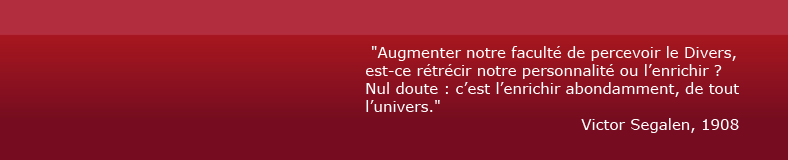Imprimer  |
|


La reconnaissance du bilinguisme des enfants de migrants : un atout pour l’intégration.
Posté par Anna Stevanato le 9 mai 2011
Anna Stevanato a fondé l’Association D’Une Langue à l’Autre au début de l’année 2009, à Paris. Son objectif : aider les familles multilingues à transmettre leur langue et leur culture à leurs enfants, parallèlement à une éducation en français.

Une Grande Ecole, pourquoi pas moi ?
« Une Grande Ecole : Pourquoi pas moi ? » (PQPM) est un programme d’accompagnement de collégiens et de lycéens issus de milieux modestes et habitant des quartiers en difficulté. Il est destiné à accroître leurs chances de poursuivre des études supérieures ambitieuses.
Mais quel rapport avec les langues et le bilinguisme ? Il se trouve que la plupart des élèves (82% des 72 élèves suivis) inscrits dans ce programme parlent ou comprennent une autre langue que le français.
L’association D’une Langue A L’Autre (DULALA), dont l’objet est la reconnaissance et la valorisation de toutes les formes de bilinguisme familial, participe au programme PQPM en intervenant sur le plan linguistique auprès des adolescents.
Des préjugés encore vivaces
Les premiers retours d’expérience ont permis de montrer que les préjugés sont très présents au sein même des communautés pratiquant des langues familiales non européennes.
A la question ouverte « Quelle langue associez-vous au français lorsqu’on parle de bilinguisme ? », 75% des élèves ont indiqué l’anglais, 5% l’espagnol, 5% le portugais et 15% seulement ont cité d’autres langues (turc, japonais, hébreu, lingala, bengali, créole)
L’idée selon laquelle seules les langues européennes majoritaires sont dignes de figurer parmi celles qui rendent bilingue est donc très fortement ancrée :
«Madame, est-ce qu’on peut être bilingue quand on parle d’autres langues que le français et l’anglais?» demande J., élève de 4ème.
« Le bilinguisme est une richesse si tu parles anglais ou espagnol…sinon à quoi ça sert ? » affirme B., en 2nde.
« Mon père est plurilingue, il parle 4 langues : français, anglais, tamoul et ourdou » dit B. « Oui, mais ce sont des sous-langues » rétorque C., élève de 4e.
Sur la pratique même du bilinguisme, les représentations peuvent être négatives : « Ca fait trop, deux langues à la fois dans la tête d’une personne. Il faut apprendre une langue à la fois »
« Un professeur nous a dit que nous utilisions environs 6 000 mots. Quand on est bilingue on le divise par 2 ? et quand on est trilingue, par trois ? », s’inquiète F., en 2nde.

Une Grande Ecole, pourquoi pas moi ?
Donner le goût des langues, quelles qu’elles soient
A travers des interventions ludiques, DULALA a entrepris de transformer le regard que ces jeunes portent sur la diversité linguistique et de déconstruire les représentations qu’ils se font de leurs propres langues. A ces adolescents qui ne se reconnaissent que rarement comme bilingues, ou qui vivent ce bilinguisme comme un handicap, l’association explique que non seulement parler une langue autre que le français ou l’anglais n’est pas un obstacle à l’intégration, mais que c’est au contraire une force, une richesse linguistique et culturelle. Ce travail sur l’estime de soi est un moteur pour la réussite éducative.
Et de fait, certains élèves expriment aussi le goût d’apprendre :
« Cet atelier m’a donné envie d’apprendre l’arabe » dit A., en 4 ème, dont la langue d’origine est l’algérien.
« Ce soir je vais parler bambara avec ma mère, ça va être drôle ! » décide O., en 2nde.
« Je me suis découvert bilingue passif », dit P., élève de 2nde.
« Je me suis rendu compte qu’on pouvait être bilingue même si on sait pas lire ou écrire », découvre L., également en 2nde.
Le libre choix de chacun
« Moi je parle turc seulement avec mes parents, ici je n’arrive pas », affirme J, en 2nde.
De fait, partager un mot ou des phrases dans sa propre langue maternelle est un exercice qui est loin d’être banal : certains le font avec fierté et enthousiasme tandis que d’autres sont plus discrets et intimidés, et d’autres encore préfèrent parler une langue étrangère apprise à l’école plutôt que s’exprimer dans leur langue maternelle.
Des raisons ethniques, familiales ou linguistiques, peuvent faire que la personne n’a pas envie de s’afficher comme un représentant d’une langue ou d’un pays. Ce choix est à respecter et l’élève concerné doit avoir la possibilité de s’intéresser ou non, de parler et partager cette langue ou pas.
Car une langue est loin d’être neutre, elle ne porte pas que des sons, elle nous renvoie à notre plus profonde identité.
*******************************************************************************
Pour plus d’informations : www.dunelanguealautre.org