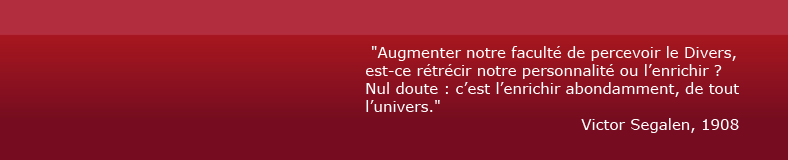Imprimer  |
|


Du monolinguisme populaire traditionnel au monolinguisme de langue d’Etat : un obstacle au plurilinguisme
Posté par Denis Costaouec le 25 février 2011
 Denis Costaouec est maître de conférences HDR en linguistique et phonétique générales à l’université Paris Descartes et membre du laboratoire SeDyl (CNRS, Inalco, IRD). Il travaille actuellement au Mexique dans le seul village où se parle l’ixcatèque, une langue de la famille otomangue gravement menacée de disparition.
Denis Costaouec est maître de conférences HDR en linguistique et phonétique générales à l’université Paris Descartes et membre du laboratoire SeDyl (CNRS, Inalco, IRD). Il travaille actuellement au Mexique dans le seul village où se parle l’ixcatèque, une langue de la famille otomangue gravement menacée de disparition.
Dans mes activités de linguiste de terrain (Paraguay, Bretagne, Mexique), j’ai souvent été confronté à des situations où des populations étaient passées d’un monolinguisme traditionnel (dans telle variété de guarani, en breton ou dans une langue de la famille otomangue) à un monolinguisme dans la langue de l’État (espagnol ou français), via une période assez brève (2 ou 3 générations) de bilinguisme subi et problématique.
Il s’agit de cas assez courants pour qu’on s’y arrête, et je défends donc ici la thèse selon laquelle il existe dans le monde de nombreuses situations de monolinguisme populaire ancestral qui semblent souvent favoriser l’abandon de la langue première en cas de bilinguisme imposé. Ce processus conduit en général à un nouveau monolinguisme dans la langue dominante.
Nous devons tout d’abord considérer le monolinguisme durable comme la réalité quotidienne des masses populaires dans certaines régions du monde.
Certaines situations locales décrites comme bilingues ou plurilingues masquent en fait un monolinguisme dominant : c’était le cas par exemple dans l’Empire ottoman où coexistaient de nombreux groupes linguistiques, se partageant le même espace, parfois les mêmes villages, dans une organisation sociale essentiellement fondée sur les distinctions religieuses, sans volonté d’unification linguistique.
Pour autant, un tel contexte favorable au plurilinguisme a accouché d’une grande diversité de situations : à côté des marchands et des notables maîtrisant plusieurs langues dont le turc, les paysans pauvres – et les femmes notamment –, vivent dans une situation de monolinguisme local dont témoignent différentes chroniques, et même des études récentes.
Dans de telles situations, seuls quelques individus se trouvent engagés dans des relations sociales qui imposent un contact avec la langue du pouvoir ou avec d’autres langues. Le résultat le plus courant est que la majorité de la population est monolingue : quand rien dans la vie quotidienne ne nécessite de contacts avec des populations de langue différente, le monolinguisme est la réponse adéquate et suffisante aux besoins sociaux de communication.
Il nous faut dès lors prendre la mesure de ce monolinguisme durable dans la vision du monde qu’il développe, dans le sentiment d’unicité langue-monde qu’il induit. On peut comprendre l’ébranlement, le traumatisme probablement, que constitue l’irruption d’une autre langue dans cette construction complexe.
Dans ces situations, l’imposition d’une deuxième langue, souvent celle du pouvoir d’État ou de l’envahisseur, crée une situation conflictuelle, perturbante. La langue première est dévalorisée aux yeux de ceux qui la parlaient, l’apprentissage de la langue 2 se fait de manière très inégale, sa maîtrise reste longtemps insuffisante, ce qui est socialement stigmatisé. Un tel bilinguisme imposé est alors ressenti comme perturbant et néfaste.
Le résultat régulièrement observé de l’inégalité de statut entre les deux langues, qui reflète une inégalité de statuts politiques et économiques entre fractions de la population, est l’abandon de la langue première au profit d’un nouveau monolinguisme, dans la langue dominante cette fois.
La politique de bien des États-nations n’a alors fait que renforcer cette tendance au monolinguisme populaire en imposant un monolinguisme dans la langue officielle appelée à se substituer aux langues autochtones dans tous les aspects de la vie sociale. La réussite du monolinguisme d’État se fonde donc aussi sur les traditions de monolinguisme local.
On peut tirer de ces réflexions les conclusions suivantes si l’on veut mettre en place des politiques de promotion du plurilinguisme qui visent les peuples et pas seulement les classes dirigeantes et les catégories sociales influentes : toute promotion du plurilinguisme doit prendre en compte les situations décrites, et leur logique propre, que l’on peut résumer dans cette réalité sociolinguistique majeure : la pratique des langues dépend du besoin social qu’on en a.
On ne peut donc pas seulement compter sur un discours qui valorise le plurilinguisme « en soi », y compris par des arguments démocratiques (refus des inégalités liées à la maîtrise d’une seule langue, défense de la diversité culturelle, surcroît d’autonomie, mobilité facilitée tant au plan social que géographique, etc.). La promotion du plurilinguisme en direction des couches populaires ne peut pas se satisfaire de l’argumentaire destiné aux couches directement engagées dans les échanges internationaux, la construction européenne, la mondialisation des échanges. Elle ne peut pas se limiter à la promotion de certaines langues d’État (français, allemand, espagnol…) contre l’omniprésence de l’anglais.
Pour être comprise et acceptée, la promotion du plurilinguisme doit intégrer la promotion des « autres » langues : les langues de l’immigration comme les langues régionales.