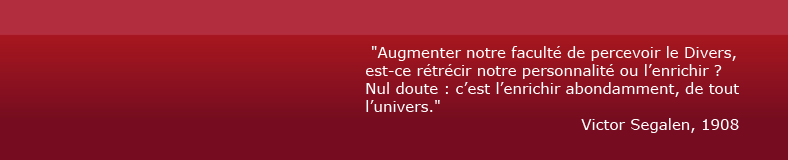Imprimer  |
|


31 octobre 2011 : article de l’AFP sur les derniers locuteurs de langue patua à Macao
Le patua est un créole à base portugaise, cantonaise et malaise, avec également des traces de quelques autres langues comme le hindi ou le japonais. On l’appelle aussi la « langue douce de Macao », ou encore le « parler chrétien ».
La langue a été classée comme étant en « situation critique » par l’UNESCO. De fait, il resterait seulement une poignée de locuteurs à Macao, et peut-être quelques centaines à l’étranger parmi la diaspora.

Dona Aida de Jesus - AFP
Il est vrai qu’il est difficile de lutter contre l’empire chinois qui a repris la main sur la ville en 1999, et surtout de trouver une place dans la plus grande ville de jeu du monde !
Mais la cause principale de l’abandon du patua par ses locuteurs est à chercher bien avant cela, dès le 19ème siècle : les écoles portugaises interdisaient alors la pratique d’une langue jugée dépassée. S’en est suivi un processus présent un peu partout ailleurs dans le monde : un rejet par les locuteurs de leur propre langue, qu’ils ont fini par considérer comme étant sans valeur.
Au fur et à mesure que l’éducation se généralisait, le patua déclinait donc, et au début du 20ème siècle, il était devenu la langue des femmes, parlée à la maison, avec les enfants, parfois dans la rue, mais pas à l’école ou sur les lieux de travail.
Aujourd’hui, l’identité comme la langue de Macao sont diluées : ils ne sont plus que 8 000 habitants d’origine à y vivre, la majorité ayant fui avant la rétrocession à la République Populaire de Chine, et la plupart se définissent désormais comme Chinois.
Ils sont tout de même quelques uns à se battre pour que la langue survive malgré sa vulnérabilité dans cet univers peu favorable. L’avocat Miguel Senna Fernandes est de ceux-là: il monte chaque année une pièce de théâtre satirique en patua, et parvient à attirer non seulement des spectateurs mais aussi de jeunes apprentis comédiens qui ne connaissent pas la langue mais ne demandent qu’à apprendre. Sauront-ils faire mentir les prévisions de l’UNESCO ?
Pour lire l’article (en anglais)