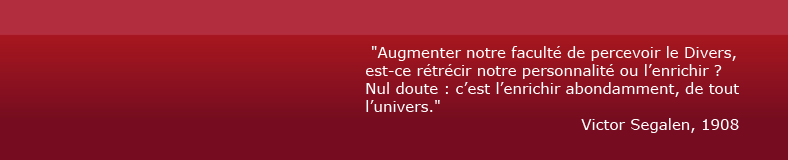Imprimer  |
|


Déclin et avenir des langues
Sorosoro ne s’intéresse pas seulement à la préservation des langues. Nous estimons qu’il est aussi important, lors de nos tournages, de recueillir la parole des locuteurs sur des sujets contemporains.
Par exemple, nos équipes leur posent des questions sur la façon dont ils vivent le passage d’un mode de vie traditionnel à un mode de vie plus urbain, plus technologique, sur les problèmes que ces changements apportent, sur la manière dont ils envisagent leur propre avenir.
Sur la langue, nous leur demandons ce qui, de leur avis, en cause le déclin, et s’ils pensent qu’elle survivra aux contacts avec l’extérieur et au contexte de la mondialisation. Et il s’avère souvent que, d’un coin à l’autre du monde, les mêmes causes ont les mêmes effets, et les situations décrites sont souvent similaires.
La langue akélé
L’akélé des lacs, aussi appelé mutumbudié (ou metombolo) n’est plus parlé que par une cinquantaine de personnes, dans la région des lacs, au Gabon.
Sorosoro a demandé à deux locuteurs, Théodosie et Jean Kédine, de nous parler du destin de leur langue.
Voir la page sur la langue akélé
Voir toutes les vidéos en akélé
Le déclin de la langue akélé expliqué par Théodosie
Le déclin de la langue akélé expliqué par Jean Kédine
Linguiste : Jean-Marie Hombert
Image et son : Luc-Henri Fage
Traduction : Hugues Awanhet
Montage : Caroline Laurent
La langue punu
Le punu est la langue des Bapunu, la deuxième ethnie du Gabon en population. C’est une langue bantu parlée dans la région de Tchibanga. Le déplacement récent de Bapunu de plus en plus nombreux vers les grands centres urbains entraîne une perte progressive des connaissances de la culture et de la langue.
Sorosoro a demandé à un locuteur, Kwenzi Mickala, de nous parler du déclin de sa langue.
Voir la page sur la langue punu
Voir toutes les vidéos en punu
Linguiste : Jean-Marie Hombert
Image et son : Luc-Henri Fage
Montage : Caroline Laurent
La langue mpongwè
Les Mpongwè sont, après les Pygmées Akowa aujourd’hui disparus, les premiers habitants de Libreville, sur la rive droite de l’estuaire du Gabon. Le nombre de locuteurs est réduit puisqu’on en compte moins de 5000. Conscients du danger de disparition de leur patrimoine traditionnel, les Mpongwè ont créé des structures pour la sauvegarde de la langue et de la culture.
Sorosoro donne la parole à deux personnes issues de la communauté Mpongwè au Gabon, Henriette et Kialla, qui nous parlent de leur vision de l’avenir de leur langue.
Voir toutes les vidéos en mpongwè
Le déclin de la langue mpongwè par Henriette
L’évolution de la langue mpongwè par Kialla
Linguiste : Patrick Mouguiama-Daouda
Image et son : Muriel Lutz
Montage : Caroline Laurent
La langue kaqchikel
Le kaqchikel est une des 30 langues mayas (21 sont parlées au Guatemala et 9 au Mexique). On estime à environ un demi-million le nombre de locuteurs de kaqchikel, majoritairement bilingues en espagnol. Malgré une situation démographique à priori favorable, le kaqchikel, en perte de vitesse chez les jeunes générations, se transmet de moins en moins. Avec lui, des pans entiers de la culture et des savoirs mayas sont menacés de disparition.
Sorosoro a demandé a B’alam Tija, locuteur de kaqchikel, de nous parler du déclin de sa langue.
Voir toutes les vidéos en kaqchikel
Linguiste : Nikte Sis Iboy
Image et son : José Reynès
Montage : Caroline Laurent
La langue tamasheq
Le tamasheq, la variante du tamazight (berbère) que parlent les Touaregs, est une langue encore très vivante, avec plus d’un million de locuteurs. Mais quel est l’avenir de cette langue du désert dans un contexte de plus en plus urbain et mondialisé ?
Que deviendra cette culture spécifique dès lors que de plus en plus de jeunes choisissent l’exode ? Pourquoi la langue orale est-elle insuffisante et faut-il aussi insister sur l’apprentissage de la lecture ? Que perdrait le monde s’il perdait la langue tamasheq… ?
Voir toutes les vidéos en tamasheq
Image et son : Arnaud Contreras
Montage : Caroline Laurent
La langue xârâcùù
La langue xârâcùù est l’une des 28 langues kanak, parlées en Nouvelle-Calédonie, la 4ème la plus parlée en après le drehu, le nengone et le paicî. Au final, elle est l’une des langues kanak qui se maintiennent le mieux : pratiquée dans toutes les communes de l’aire linguistique Xârâcùù, elle atteint même plus de 90% de la population à Canala.
Voir toutes les vidéos en langue xârâcùù
Voir le site de l’Académie des Langues Kanak
Questions d’identité avec Marie-Adèle Jorédié
Voici un interview de Marie-Adèle Jorédié, militante et enseignante connue pour avoir mis sur pied le programme des Bb-lecture, un programme destiné à introduire le livre auprès des petits enfants kanak. Elle nous parle de son rapport à sa langue, de ce qu’elle représente pour les Kanaks, et aussi de la nécessité de la transmettre, en particulier en utilisant les moyens apportés par « les blancs » : le livre et l’école.
Marie-Adèle Jorédié et les Bb lecture en langue xârâcùù
Au milieu des années 80, Marie-Adèle participe en effet à la création des Ecoles Populaires Kanak (EPK), des écoles en immersion linguistique. Puis elle monte en 1999 les Bb lecture, une initiation au livre pour les petits avant qu’ils n’aillent à l’ «école des blancs ». Et parallèlement, elle continue d’enseigner le xârâcùù au collège de Canala…
Un parcours bien rempli, donc, qu’elle nous raconte ici, sur fond de « classe » bien particulière, une classe où il est question d’éléphants et où l’on apprend l’alphabet en chansons…
Linguiste : Claire Moyse-Faurie, du LACITO/CNRS
Images et son : José Reynes assisté de Karl Jorédié
Traduction : Annick Kasovimoin, de l’Académie des Langues Kanak (ALK)
Montage : Caroline Laurent