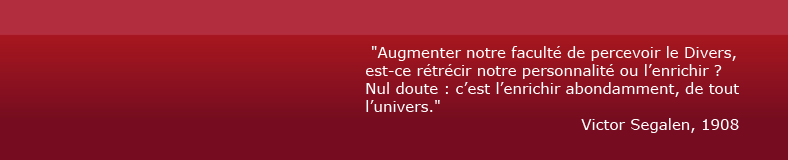Imprimer  |
|


Famille des langues zamucoanes
Où sont parlées les langues zamucoanes ?
Ces langues sont parlées dans la région du Chaco Boréal dans le sud-est de la Bolivie et au nord du Paraguay.
Nombre total de locuteurs (estimation) :
5570 selon le site Ethnologue
6100 selon Fabre (2007).
Classification
Excepté le Zamuco de chome (éteint), la famille zamucoane compte deux langues actives.
Ayoreo : 3770 locuteurs selon le site Ethnologue
4500 locuteurs selon Fabre (2007) et Combès (2009).
D’autres noms ont été attribués à cette langue, d’après les noms habituellement donnés à ce groupe ethnique tels que : Moro, Morotoco, Samococio, Takrat, Coroino, Potureros, Guarañoca, Yanaigua, Tsirákua, Pyeta Yovai (voir Fabre 2007, Combès 2009 et le site Ethnologue)
Chamacoco : 1800 locuteurs selon Ethnologue
1600 locuteurs selon Fabre (2007).
D’autres noms ont été attribués à cette langue (voir la mention ci-dessus): Ishiro, Jeywo, Yshyro (voir le site Ethnologue)
principaux dialectes : ebitoso, tomaraho
Pour plus d’informations sur la classification linguistique, consultez Fabre 2007 (voir dans les sources citées plus loin) et le site Ethnologue. Certaines incertitudes demeurent sur plusieurs des noms ethniques, pour cela vous pouvez consulter Combès (2009).
Commentaires sur la classification des langues zamucoanes :
Les langues ayoreo et chamacoco ont un ancêtre commun, la langue zamuco, à ne pas confondre avec la langue zamuco de chome décrite par le missionnaire jésuite Ignace Chomé dans la première moitié du XVIII e siècle. Chomé a écrit une remarquable grammaire, Arte de la lengua zamuca. Même si l’ayoreo et le chamacoco n’ont que 30 % de leur lexique en commun, on retrouve des preuves évidentes pour cette classification tant sur le plan morphologique que typologique (voir Bertinetto, 2009 et Ciucci, 2009). Le zamuco de chome parlé à S. Ignacio de Samucos (voir plus loin), est une forme archaïque de l’ayoreo selon Kelm (1964). Les deux langues ont quasiment le même lexique ; il est toutefois impossible de vérifier si l’ayoreo provient du zamuco de chome ou d’une des langues de même origine, peut-être d’un des dialectes par les jésuites au XVIII e siècle (i.e. caipotorade, morotoco, ugaraño selon Hervas, 1784). La division du chamacoco en deux dialectes, l’ebitoso et le tomaraho, est reconnue. La plupart des Chamacocos parlent l’ebitoso, le dialecte tomaraho n’est parlé que par un petit nombre de locuteurs (103 selon Fabre, 2007).
Les langues zamucoanes sont-elles en danger ?
D’après l’UNESCO, ces langues sont en danger (voir Crevels & Adelaat, 2000/2006). Même si tous les Ayoreos parlent couramment leur langue, de même la plupart des Chamacocos parlent leur langue chez eux (selon Fabre, 2007). Dans ces deux communautés, de nombreux éléments culturels tendent à être compris difficilement par les personnes d’âge moyen et le bilinguisme augmente. Ce qui va certainement conduire à une forme de romanisation des langues zamucoanes, et peut-être, dans quelques générations, à leur disparition. Le chamacoco (du moins le dialecte ebitoso) semble plus affecté que l’ayoreo par le contact avec la langue dominante, le castillan, et dans une certaine mesure par le guarani.
Éléments ethnographiques:
Le mot ayoreo est l’adaptation d’un endoethnonyme qui signifie «personne (réelle)» (ayorei M. SG). De même, le premier nom du chamacoco, ɨshɨr, signifie “personne”. L’ayoreo et le chamacoco sont deux groupes ethniques différents, tous deux ont été assez tardivement en contact avec la culture occidentale, et ce, à différentes périodes. Les missionnaires jésuites sont les premiers à être entrés en contact avec les tribus zamucoanes, lorsqu’ils ont établi la mission de S. Ignacio de Samucos, dans la région du Chaco, en Bolivie en 1724. Cela a permis à Ignace Chomé de décrire leur langue. La mission en question a eu une profonde influence culturelle sur le peuple zamucoane, mais n’a pas concerné tous les zamucos. D’après Combès (2009), on peut retrouver des preuves anthropologiques attestant de l’influence jésuite chez les ayoreos mais pas chez les chamacocos. Lors du départ des missionnaires en 1745, de nombreux membres de ces tribus ont retrouvé leur mode de vie traditionnel dans la forêt du nord du Chaco. D’autres sont restés à l’intérieur (ou à proximité) des missions jésuites de la zone de Santa Cruz et ont progressivement adopté la langue et la culture du groupe ethnique dominant, les chiquitanos.
Avant la colonisation, les ayoreos et les chamacocos étaient des nomades, ils pratiquaient la chasse et la cueillette sur un territoire au climat particulièrement hostile. Leur culture et leur vie quotidienne était profondément influencées par une nette opposition entre des périodes de fortes pluies en été et une saison sèche en hiver. L’hiver était donc une période très difficile pendant laquelle ils devaient s’adapter pour survivre. L’accès aux ressources naturelles était donc inévitablement source de conflits avec les tribus voisines, et même à l’intérieur d’un groupe ethnique ; la guerre jouait donc un rôle central dans leur vie. Traditionnellement, les ayoreos et les chamacocos sont divisés en sept clans aux noms similaires. Leur artisanat comprend des ornements en plumes et des produits réalisés en tissant les fibres d’une plante appelée caraguatà et qui pousse dans la zone du Chaco (Fishermann, 1988).
La première description de la culture chamacoco est due à Guido Boggiani, un peintre et photographe italien (Boggiani, 1894). Le dernier contact avec les ayoreos a été établi par des missionnaires évangéliques dans les années 1940. Pour plus d’informations, voir Combès (2009).
Précisions linguistiques
Toutes les langues zamucoanes ont des systèmes de transcription réalisés par des missionnaires à différentes périodes. Ces transcriptions suivent l’orthographe castillane.
L’ayoreo et le zamuco de chome ont cinq voyelles (a, e, i, o, u), alors que le chamacoco a une voyelle de plus, /ɨ/, une voyelle haute et centrale qui se retrouve dans d’autres langues de la région. La nasalité des voyelles est un trait phonologique distinctif de ces langues. L’harmonie nasale est un autre trait morpho phonologique commun à ces langues, nasalisation qui se manifeste particulièrement dans les affixes. Il est intéressant de noter que l’ayoreo et la chamacoco ont certaines consonnes nasales non voisées.
Les langues zamucoanes sont fusionnelles et leur structure morphologique est simple comparée à la plupart des langues avoisinantes, qui sont caractérisées par une structure très agglutinante. Les substantifs s’infléchissent en nombre (singulier et pluriel) et en genre (masculin et féminin) ; par exemple en ayoreo les mots pour « personne » sont ayorei (M. SG), ayoreode (M. PL), ayoré (F. SG) et ayoredie (F. PL). L’ayoreo présente une opposition systématique entre les formes « de base » et les formes « pleines » dans la morphologie nominale. La forme « de base » (qui a un pluriel propre) est, au singulier, la source de toute opération morphologique (inflexion, dérivation, construction) et elle a également des fonctions syntaxiques.
Le chamacoco présente la même opposition entre forme « de base » et forme « pleine ». Les langues zamucoanes ont une caractéristique commune à la région, c’est-à-dire une inflexion des noms, qui sont divisés entre « possédable » et « non-possedable »: le premier, lorsqu’il est utilisé, utilise les préfixes possessifs correspondants, alors que pour les noms « non-possédables » il faut des classificateurs spéciaux, comme c’est le cas pour la langue ayoreo. Le prototype de cette langue suit un ordre SVO (sujet-verbe-objet), toutefois, la construction génitive, qui consiste en une simple juxtaposition de substantifs, les déterminants précèdent l’élément auquel il se rapporte. La présence de postpositions (adpositions placées après le complément) porte à croire que ces langues ont subi un changement typologique.
La morphologie verbale ne présente pas d’inflexion de temps, les références temporelles sont exprimées au moyen d’adverbes. Il existe une forme indicative et une forme non-indicative, la première véhicule un sens modal. Cette caractéristique et bien d’autres mènent à penser que ces langues sont principalement modales (voir Bertinetto, 2009). Les déclinaisons verbales sont simples et régulières. De façon surprenante, les exceptions morphologiques ont souvent des correspondances aussi bien en ayoreo qu’en chamacoco (voir Ciucci, 2007/2008, Ciucci 2009 et Bertinetto, 2009), ce qui laisse supposer un lien profond, bien que distant, entre ces deux langues. Le chamacoco présente une forte opposition commune entre inclusif et exclusif à la première personne du pluriel, une caractéristique que l’on ne retrouve pas dans la langue ayoreo (ni dans la langue chomé zamuco).
Certains textes et dictionnaires sont disponibles et ont, pour la plupart, été écrits par des missionnaires (voir le site Ethnologue). Le Nouveau Testament, par exemple, a été traduit en ayoreo et en chamacoco. Une description grammaticale et scientifique est en cours d’élaboration (pour plus d’informations, consultez Bertinetto, 2009 et Ciucci, 2007/20008 et 2009) <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL09.htm>. Pour en savoir plus sur ce projet, voir aussi <http://linguistica.sns.it/Ricerca.htm>).
Sources
Bertinetto, Pier Marco 2009. “Ayoreo (Zamuco). Esquisse grammaticale”. Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore 8 n.s. URL: <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL09/Bertinetto_1.PDF>
Bertinetto, Pier Marco 2010. « How the Zamuco languages dealt with verb affixes ». Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore 9,1 n.s. URL: <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL10/Bertinetto_Zamuco.pdf>
Bertinetto, Pier Marco, Ricci, Irene, Zhi Na 2010. « Le nasali sorde dell’ayoreo: prime prospezioni ». Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore 9,1 n.s. URL: <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL10/Bertinetto-Ricci-Zhi.pdf>
Boggiani, Guido 1894. I Ciamacoco. Conferenza tenuta in Roma alla Società Geografica Italiana il giorno 2 giugno 1894 ed in Firenze alla Società Antropologica il 24 dello stesso mese. Roma: Società Romana per l’Antropologia.
Chomé, Ignace 1958 [1745 ca.]. Arte de la lengua Zamuca. Présentation de Suzanne Lussagnet. Journal de la Société des Américanistes de Paris 47. 121-178.
Ciucci, Luca 2007/08. Indagini sulla morfologia verbale nella lingua ayoreo. Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore 7 n.s. URL: <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL07_08/Ciucci_2.PDF>
Ciucci, Luca 2009. Elementi di morfologia verbale del chamacoco. Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore 8 n.s. <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL09/Ciucci.pdf>
Ciucci, Luca 2010a. « La flessione possessiva dell’ayoreo ». Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore 9,2 n.s. URL: <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL10/Ciucci_ayoreo.pdf>
Ciucci, Luca 2010b. La flessione possessiva del chamacoco. Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore 9,2 n.s. URL: <http://linguistica.sns.it/QLL/QLL10/Ciucci_chamacoco.pdf>
Combès, Isabelle 2009. Zamucos. Instituto de Misionerología, Cochabamba.
Crevels, Mily & Wilhelm F. H. Adelaar 2000/06. South America. UNESCO Red Book of Endangered Languages. University of Tokyo. Version disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/archive/RedBook/SAmerica/SA_index.cgi .
Ethnologue = Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Version en ligne: http://www.ethnologue.com/.
Fabre, Alain 2007. Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. Version disponible en ligne à l’adresse suivante :
<http://butler.cc.tut.fi/~fabre/BookInternetVersio/Alkusivu.html>
Fishermann, Bernd 1988. Zur Weltsicht des Ayoréode Ostboliviens. Rheinischen Friedric-Wilhelms-Universität: Bonn (une traduction récente en castillan publiée à La Paz est désormais disponible).
Hervás y Panduro, Lorenzo 1784. Catalogo delle lingue conosciute e notizia della loro affinità, e diversità. Cesena: Gregorio Biasini.
Kelm, Heinz 1964. Das Zamuco: eine lebende Sprache. Anthropos 59. 457-516 & 770-842.
(Pour plus de références bibliographiques, voir Fabre, 2007)
Cette fiche a été réalisée par Pier Marco Bertinetto and Luca Ciucci, 2010
Si vous avez des informations complémentaires sur cette langue n'hésitez pas à nous contacter : contact@sorosoro.org