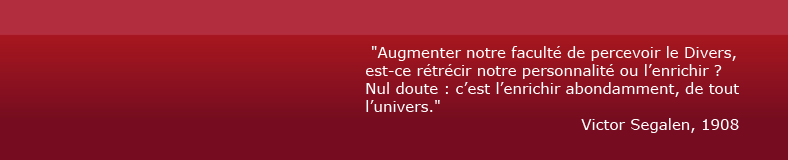Imprimer  |
|


Juin 2011 : interview de Barbara Glowczewski pour la sortie de « The Challenge of Indigenous Peoples » (Le défi des peuples autochtones)

Barbara Glowczewski est Directrice de recherches au Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS/EHESS/Collège de France). Elle travaille en particulier avec les peuples aborigènes d’Australie. Auteur de nombreux livres, articles et films, elle participe par ailleurs régulièrement à des expositions d’art aborigène.
Elle co-édite avec Rosita Henry, professeur en anthropologie à l’Université James Cook en Australie, un nouvel ouvrage collectif intitulé « The challenge of indigenous peoples ». Ce livre, qui rassemble des anthropologues et des artistes, explore les façons dont les peuples autochtones expriment leurs identités sociales et culturelles à travers l’art et la politique.
Barbara, c’est un ouvrage collectif qui rassemble des auteurs de plusieurs horizons, de quels peuples parlent-ils ?
Huit auteurs se fondent sur leurs expériences respectives auprès d’Aborigènes de différentes régions d’Australie : Warlpiri et Kukatja du désert central et de l’ouest, Yolngu et Yanyuwa, Garrwa, Mara et Kurdanji du Territoire du nord, Kija et Yawuru/Djabirr Djabirr du Kimberley ainsi que des artistes des villes du sud.
Trois autres chapitres analysent la situation de peuples océaniens réunis à l’occasion de trois festivals du Pacifique sud, particulièrement les Bunabans, les Mélanésiens des îles Solomon, et les habitants de Palau.
Enfin sont traités deux exemples de situations autochtones : Adivasi d’Inde et Khanty et Mansi de Sibérie.
Pourquoi avoir restreint la zone géographique à l’Asie / Pacifique Sud/ Sibérie, et avoir ainsi laissé de côté l’Afrique et les Amériques ?
Ce livre, est la traduction mise à jour du Défi indigène publié en 2007 suite à un programme de collaboration que nous avions monté avec Rosita Henry pour accompagner de jeunes chercheurs travaillant en Australie.
Nous avons organisé diverses rencontres internationales et séminaires où nos collègues océanistes, et spécialistes d’Inde et de Sibérie sont venus enrichir la réflexion comparative ; celle-ci a continué avec des exemples d’autres continents pour des publications à venir.
Le titre du livre est assez large, car les peuples autochtones font face à bien des défis. De quels défis en particulier voulez-vous parler ?
Le sous-titre pose une question « spectacle ou politique ? » car il cherche à répondre aux préjugés et dénis de la singularité culturelle des groupes autochtones qui s’exposent sur des scènes publiques.
Pour ces groupes, l’enjeu est un défi de survie et de reconnaissance : affirmer un droit d’existence en produisant l’image qu’ils souhaitent donner d’eux-mêmes à la fois comme démarche culturelle et comme énoncé politique sur l’auto-détermination, pour changer le regard postcolonial.
Pourquoi avoir choisi l’expression artistique plutôt que les revendications plus purement politiques ?
Les Aborigènes d’Australie ont ces vingt dernières années révolutionné l’histoire de l’art contemporain par leurs productions tangibles et intangibles qui portent un message politique.
Bien d’autres peuples autochtones s’inscrivent dans ce mouvement : par la créativité de leurs cultures, ils luttent contre les discriminations. La récente signature de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones par les pays membres de l’ONU en témoigne.
Quel public cherchez-vous à toucher à travers cet ouvrage ?
Nous nous adressons à tous les publics à l’heure où la survie de la planète et de sa biodiversité repose en partie sur la reconnaissance de sa diversité culturelle.
Liste des contributeurs de l’ouvrage :
Wayne Jowandi Barker; Jessica De Largy Healy; Barbara Glowczewski; Rosita Henry; Wolfgang Kempf; Jari Kupiainen; Stéphane Lacam-Gitareu; Géraldine Le Roux; Arnaud Morvan; Martin Préaud; Dominique Samson Normand de Chambourg; Alexandre Soucaille; Anke Tonnaer
Le livre est disponible à l’achat (en anglais uniquement) sous format papier ou sous format électronique.
Pour en savoir plus et/ou acheter le livre
Pour lire la biographie de Barbara Glowczewski, membre du Conseil Scientifique de Sorosoro