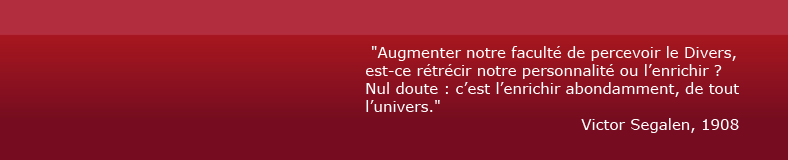Imprimer  |
|


Des Dogons aux corons
Chez les Dogons du Mali, l’enfant reçoit la parole (so) à la naissance, au moment où il passe de l’état de poisson silencieux dans l’eau-mère à celui de petit d’homme sur la Terre. Après l’expulsion du placenta, une femme crachote de l’eau – élément que le bébé vient de quitter et qui est la vie même – sur sa figure. Le contact des gouttelettes le fait crier : il a reçu officiellement la parole. Et les dents de la femme à travers lesquelles l’eau est passée sont comme le peigne du tisserand qui trame les fils d’une étoffe à venir : le langage.
Avant de boire le lait de sa mère, le bébé boit de l’eau de sá (sá dì) une boisson très sucrée obtenue à partir des fruits du Lannea acida, une plante appelée soon en Wolof, bembay en Peul, pekuni en Bambara et dugun en Serer. L’arbuste symbolise le triomphe de la vie sur la mort car il verdoie pendant la saison sèche. L’eau de sá, considérée par les Dogons comme la plus douce des boissons, met l’enfant sous la protection de Nommo (le sauveur, fils d’Amma éternel et incréé.)
Le jeune Dogon apprend d’abord à parler avec sa maman. Tant qu’elle le porte sur le dos, elle utilise un langage bébé dont le premier mot est mammam qui signifie « boire ». Lorsqu’elle lui apprend à marcher, elle guide ses pas en scandant la syllabe tà tà tà (une abréviation de tànala « marcher »). À cet âge-là, le petit enfant prononce les dentales dà (« maman ») et dé (« papa »). Quand il se tient debout tout seul, la mère abandonne le langage enfantin pour le langage adulte. Elle lui montre les objets en répétant les mots à plusieurs reprises d’une voix aussi douce que l’eau de sà. Tant qu’elle le nourrit au sein (jusqu’à l’âge de deux ans environ) la mère parle à son enfant dans son propre dialecte (elle est souvent originaire d’un autre village). L’enfant dogon comprend et parle donc d’abord le dialecte maternel, mais en grandissant il devra utiliser celui du village de son père, dans lequel il vit, puisque la résidence est patrilocale.
Lorsqu’il est sevré, le garçonnet peut suivre son papa dans la brousse. Celui-ci lui enseigne le nom des animaux, des plantes, des techniques et outils agricoles. La fillette, elle, poursuit son éducation auprès de sa mère, le père ne s’en mêlant jamais.
Lorsqu’il est assez grand pour s’éloigner de ses parents, le petit dogon fille ou garçon va jouer avec ses frères et sœurs plus âgés et leurs camarades. Comme tous les enfants du monde, ceux-ci s’empressent de lui apprendre des jeux et le langage qui s’y rapporte. Ce sont eux qui l’initient aux subtilités des « moqueries de villages », plaisanteries échangées par les habitants des bourgs et bourgades d’une même région linguistique pour se moquer de l’accent, du vocabulaire propre à chacun et du caractère, des défauts typiques de leurs habitants. Le but du jeu ? La thérapie par le rire ou comment désamorcer les tensions en maîtrisant le « lancer de vanne » et l’art du tac au tac.
Dans l’hexagone, le succès populaire du film « Bienvenue chez les Ch’tis » confirme l’intérêt que les homo sapiens portent aux moqueries de village ou plutôt de région. Ce qui revient à penser que, du Nord de la France aux falaises de Bandiagara, la diversité n’est pas un élément de trouble mais d’équilibre [elle] rattache plus étroitement l’individu à ses racines et lui donne une conscience plus forte d’appartenir à une société et à une culture précises, lui permet de s’affirmer davantage comme élément d’un groupe.
Félicie Dubois
(D’après « Ethnologie et langage » de Geneviève Calame-Griaule, Ed. Gallimard, 1965.)